Accueil > Articles > 2005 > Le rire scatologique est-il soluble dans la publicité ? (Sur Wim (...)
Le rire scatologique est-il soluble dans la publicité ? (Sur Wim Delvoye)
vendredi 3 décembre 2021, par
Suite à l’appel à contribution, j’avais envoyé cette proposition autour de Wim Delvoye. Christian Moncelet m’avait immédiatement fait confiance. Qu’il en soit ici encore remercié car, après cette question de la scatologie reste pour moi un travail à prolonger. Voici le texte tel qu’il a paru, sans ajout ni modification. J’y ajoute seulement quelques images envoyées par Wim DElvoye au moment de la rédaction de cet article.
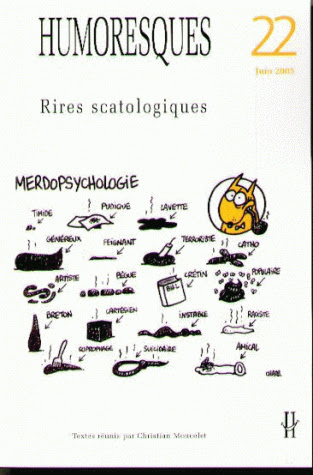
Alors quoi, merde, dit Zazie, on va le boire ce verre ? (…)
C’est hun cacocalo que jveux. »
Raymond Queneau
dans la publicité ?
Préam-bulle
En 2002 (du 21 avril au 23 juin), on pouvait voir au S.M.A.K. (Musée d’art contemporain de Gent en Belgique) une rétrospective de l’œuvre de Jannis Kounellis.
Si passionnante que fût cette exposition, c’est tout à fait autre chose qui sera évoqué. Un alentour, un dispositif annexe et publicitaire attendant le spectateur à la sortie de l’exposition. Le musée proposait en effet à ce moment du parcours, sur présentation du ticket d’entrée, un choix de boîtes de Coca Cola.
Un cadeau.
Un cadeau gazeux pour une exposition sponsorisée par une marque de café.
En réalité, il y avait quatre boîtes de cette boisson mondialiste. Quatre boîtes parmi lesquelles choisir.
Il ne s’agissait pas de choisir entre des variétés sans sucre, ou avec sucre. Il fallait choisir entre quatre illustrations, quatre interventions, quatre décorations, quatre formes, quatre espaces, quatre…
Quatre boîtes, selon quatre artistes contemporains belges.
Charlier
Panamarenko
Corillon
Delvoye
Parmi tous les chiffres et autres indications, on peut repérer les éléments suivants :
Charlier : B2KC08B 011628BE D145
Panamarenko : B2KC08B 011628BE D142
Corillon : B2KC08B 011628BE D144
Delvoye : B2KC08B 011628BE D143
Sur chacune d’elle on pouvait lire : « échantillon gratuit » et « édition limitée ».

Boîte de Coca Cola,
série limitée numéro B143.
C’est de la merde.
L’art contemporain, c’est de la merde.
Combien de fois, dites-moi, avez-vous entendu cette assertion, ce jugement en forme de fin de non-recevoir, cette vocifération ?
C’est assez général et constant. Il y a même des ministres qui ont usé de ce vocable pour qualifier l’art contemporain [1].
De la merde ?
Alors, oui, il sera ici encore question de merde… d’art, de merde, d’argent et de publicité.
La canette de Coca Cola offerte par le musée d’art contemporain de Gent et signée (en bas, à gauche) Wim Delvoye repose les questions des limites de l’intervention de l’artiste dans le monde économique et publicitaire tout en poursuivant une interrogation de la merde dans l’art.
Description
Une canette de Coca Cola light est une canette de Coca Cola light comme toutes les autres canette de Coca Cola light (in memoriam Gertrude Stein)
Une canette de Coca Cola light selon Wim Delvoye est une canette de Coca Cola light selon Wim Delvoye, peut-être, mais c’est surtout une canette de Coca Cola light.
Description 2
(tentative)
Les deux tiers de la canette sont les mêmes que celles que l’on peut trouver dans le commerce ou dans les poubelles du monde entier.
L’enjeu esthétique et idéologique réside dans les 33 % restant.
Description 3
(nouvel essai : Portrait en pied… ou presque)
On voit le buste d’un « Monsieur Propre » (effigie publicitaire d’un produit nettoyant : personnage chauve, souriant, portant une boucle d’oreille à droite et les bras musclés croisés).
Sous les bras croisés du Monsieur Propre souriant, il y a le logo de Coca Cola, dans son losange rouge.
Mais ici l’inscription figurée est légèrement modifiée : on lit « Cloaca » avec la même typographie tourbillonnante du haut du C filant dans la boucle du L.
Donc CLOACA.
Sous l’ovale rouge dans lequel on lit cette inscription stylisée, on remarque une suite d’intestins rose orangé qui s’entrelacent et se répandent au bas de la boîte.
En bas, à gauche, le nom en guise de signature : Wim Delvoye.
Qui connaît le travail de l’artiste ne sera sans doute pas surpris par cette pseudo facétie scatologique. En effet, l’artiste belge s’intéresse depuis fort longtemps à la question des excréments, au fonctionnement des intestins et au rôle de la merde dans l’art moderne et contemporain.
Rappel des faits
Quelques détails de son activité artistique pour mesurer sa démarche :
En 1992, les sculptures Rose des vents évoquent les pets en montrant des hommes nus, un tube dans la bouche, un autre dans les fesses, en position pour faire ces vents rosés.
En 2000, il barbouille son anus de rouge à lèvre et pose sur du papier à en-tête d’hôtels un baiser de cul.

En 1999, Delvoye imagine le projet Cloaca. En 2000, il le réalise. Il s’agit d’une immense machine à produire des étrons, à faire de la merde. Réalisée avec des scientifiques et des ingénieurs, cette sculpture est une machine complexe qui reproduit la chimie digestive. Véritable chaîne alimentaire, cette sculpture transforme la nourriture, après différents bains d’enzymes, de bactéries, produits chimiques, dans un temps calculé et géré par un système électronique. Au final, on peut voir sortir d’un tube et se déposer sur un cylindre qui tourne des étrons fraîchement produits [2].
En 2002, Wim Delvoye vend sur son site des boîtes transparentes de merde issue de sa machine : 1500 $ la boîte vendue selon les techniques publicitaires les plus basiques.
Appel d’effets
La publicité. Elle fait parti des interrogations de l’artiste. Sans nul doute. Mais plus généralement, la publicité fabrique du consensus et vante un produit pour que le consommateur l’achète. Mais parfois, souvent, de plus en plus, les techniques de réclame et de vente se complexifient.
Delvoye veut provoquer un dissensus dans ce cadre particulier en mettant en avant ce thème de la merde… une provocation qui serait insoutenable pour l’enjeu consensuel inhérent à la publicité et surtout à l’image de marque de la société de soda planétaire.

Constituée comme un esprit de renversement des valeurs traditionnelles et des critères classiques du jugement, la modernité interroge les modes de pensée et de représentation en proposant des formes nouvelles et critiques. Dans l’interrogation des conditions d’existence de l’homme dans toutes ses dimensions, la question du corps ne sera pas omise, celle de la matière non plus. La merde trouve ici une place particulière dans ce travail de sape qui signe la fin du grand goût, des beaux-arts et commence à interroger avec Baudelaire, Manet, Zola ou Courbet ces formes de la décrépitude et de la décadence que sont le quotidien et l’humain dans sa corporéité la plus banale (la saleté, l’odeur, l’excrément…). C’est à partir d’une conscience aigue du paradoxe, à commencer le sien, que la modernité se fonde. Coincée, comme le rappelle Peter Bürger, entre sa nécessité et son impossibilité, la modernité est cette pensée active du renversement et de l’interrogation.
La merde, donc.
La matière fécale est fondamentalement un enjeu subversif car elle renvoie essentiellement au corps si longtemps dénié. Non seulement elle est l’incarnation du corps, mais elle en est surtout la réalité la plus brutalement refusée. La merde comme forme ultime de la corporéité engage des enjeux idéologiques. Dominique Laporte nous le rappelle en soulignant l’importance de la législation des déchets afin de participer à l’aseptisation de l’espace public et de la pensée. Car il y a une adéquation entre la langue que l’on lave de ses scories et la ville que l’on nettoie de sa merde au XV et XVIème siècle : il s’agit bien d’une mise en ordre et d’un mouvement vers l’idée de beauté. Pourtant cette sublimation esthétique et cette purification étatique n’effacent pas les paradoxes que la modernité, entre autres, saura réactiver dans une interrogation et une dénonciation de la valeur freudienne de la civilisation basée sur la trinité propreté, ordre et beauté.
La merde (sa matérialité) est donc au cœur des interrogations de l’art et de la société. Liée à la modernité, elle questionne les paradoxes de la représentation, rappelle le rôle de la matière picturale et résiste aux réifications de l’idéologie et de l’industrie culturelle en explorant des contenus de vérité qui ne sauraient se contraindre à la normalisation répressive d’un spectacle de convention. De Vinci à Cézanne, de Manzoni à Gasiorowski, des actionnistes à Gilbert & Georges, l’histoire de la merde dans l’art, tracée par Denys Riout, reste pourtant à faire. Aussi bien question de matière (du pigment au tas) que question de corps (incarnation et intimité) ou d’idéologie (du corps social à l’hygiène), aussi bien réalité que valeur symbolique, la merde est donc un enjeu religieux, esthétique ou politique. Même réduit par un discours à l’hygiénisme suspect à une invective disqualifiante, la merde dans l’art est bel et bien une question fondamentale que seuls les artistes ont réellement su poser.
La machine conçue par Delvoye poursuit cette interrogation en présentant le processus biochimique de la merde. Son intérêt réside dans ce paradoxe qui aurait sans doute intéressé Duchamp : interroger un fondement de la matière humaine dans une totale décorporéisation. L’absence de corps, le processus technoscientifique induit cette tendance hygiéniste que Duchamp lui-même n’aurait pas reniée. Reste l’odeur, diffuse malgré les vitres, les tubes et les glaces, l’odeur donc rappelant Gasiorowski ou Lizène. Mais au bout de la chaîne, il y a cet étron, aseptisé, synthèse d’une posture duchampienne et d’une confrontation technologique.
Cloaca-Coca Cola.
« Cloa-coca » explore dans une logique de concaténation ces nombreux aspects esthétiques. S’il y a la logique de la boîte duchampienne, Delvoye interroge les Merda d’artista de Manzoni. Il poursuit également un questionnement des logiques publicitaires présentes chez Duchamp comme chez Manzoni tout comme Warhol (les boîtes Brillo et les piss painting faisant ici le lien).
Mais la logique des confluences de faits et de sens dépasse la simple convergence de l’histoire de l’art, elle est également inscrite sur la boîte elle-même. La forme autotélique de Cloaca et des intestins doit être liée aux vertus digestives de la boisson gazeuse aux extraits de plantes. Et si l’on se souvient qu’à l’origine la boisson, inventée au XIXème siècle par un pharmacien d’Atlanta, trouvait sa place dans son officine comme une potion contre la fatigue et était vantée pour ses vertus digestives, on n’est pas loin de penser que Coca est une sorte de « Monsieur propre » des intestins.
Delvoye semble donc s’amuser et jongler avec toutes ces références, tous ces signes. Comme il le dit, cette boîte n’est pas une pièce d’art, c’est seulement une « intervention artistique ». Sa satisfaction est d’avoir mis « [son] logo (de merde) sur un « vrai » produit « sérieux » de consommateur. »
S’inscrivant dans une pratique du détournement, il pense sans doute retrouver là les gestes de Dada, des situationnistes, ou peut-être même des casseurs de pub. Sans doute rejoint-il certaines de ses propres œuvres comme les objets détournés, baroquisés (bouteille de butane émaillée façon porcelaine de Delft, engins de travaux public en marqueterie, vitraux de corps aux rayons X…). Mais la simple coexistence des contraires dans un jeu de citations étourdissantes est-elle un paradigme suffisant ?
Coca, c’est plus fort que toi !
Delvoye ne détourne rien de Coca Cola puisque le cadre qui lui a été fixé l’a été par la multinationale. Coca ne laisse en réalité aucune marge de manœuvre pour le moindre détournement. Peut-être laisse-t-elle (…la multinationale) l’illusion d’une frange possible d’interrogation critique à défaut de formes subversives ?
En réalité, rien de tout cela. A partir du moment où Delvoye décide de collaborer avec le marketing de Coca Cola, il est immédiatement dépendant des enjeux stratégiques de la marque, même si l’opération reste ciblée dans une sphère réduite. On manque décidément d’humour dans le monde de l’art contemporain. Navré… En fait, pas du tout. Car cette marge que Delvoye croit ouvrir contre la marque, ou en tout cas à ses dépens, la sert au contraire très fortement.
Les marques ont depuis longtemps dépassé le produit qu’elles vendent. Coca existe aujourd’hui au-delà de sa boisson, il y a moins de chaussure de sport dans Nike que de bon goût dans un hamburger. C’est dire. Noamie Klein décrit ce phénomène longuement dans son documenté best seller No Logo et Philippe Breton le souligne lorsqu’il rappelle qu’avec certaines marques le message lui-même devient le produit et que, surtout, la publicité « façonne plus globalement les consciences [et] porte en elle-même l’apologie de la société de consommation et de la culture de masse » [3].
Sans doute Delvoye pense-t-il interroger la marchandise et les enjeux de la communication de masse. Mais le cadre dans lequel il s’est laissé enfermer (les 33% de surface octroyés) induit tout geste, aussi talentueux puisse-t-il être, à répondre à une logique qui n’est pas celle de l’artiste. En ce sens Delvoye entretient un fétichisme de la marchandise en jouant le jeu de la marque, en répondant à l’impératif essentiel de la publicité.
La publicité, même dans la sophistication contemporaine de ses formes de marketing, a une finalité très simple. Elle est désir de vendre, elle incite à acheter des marchandises (ou à générer du pouvoir quand la publicité s’allie au politique, comme le rappelle Rainer Rochlitz [4]). Même si l’on peut envisager un possible artistique à la publicité, cela restera toujours subordonné à sa fonction commerciale. On peut donc dire que toute éventuelle articité est, dans le domaine publicitaire, soumise à la domination stratégique de la promotion. L’œuvre d’art garde cette autonomie par rapport à la publicité en niant toute finalité promotionnelle [5].
Wim Delvoye croit pouvoir retourner la finalité de Coca tout en préservant (faussement) l’enjeu dialectique puisque pour lui ce n’est pas de l’art. Il s’agit pourtant d’une intervention artistique dans un dispositif général entendu comme tel. Cependant l’artiste, intégré aux enjeux industriels, participe de facto à une stratégie commerciale dont la finalité reste un chiffre d’affaire.
Plus encore, Delvoye participe au renouvellement stratégique des marques qui mettent en place un système d’identification du logo comme esprit, et non plus comme objet. Cette spiritualisation de l’objet, cette dématérialisation de l’objet au profit d’un style de vie, d’un esprit d’entreprise conduit le marketing à se penser comme un courtier en signification, un fabriquant de logo comme « purs protagonistes de l’intelligence » [6]. Il n’y a plus de produit, seulement de la valeur, une valeur symbolique qui cherche à dématérialiser un processus de réification. Mais, malgré toutes les gesticulations publicitaires, la finalité reste la vente et la consommation de produits.

Coca, c’est plus fort que toi ! (2)
Consciemment ou non, Delvoye choisit de s’instrumentaliser lui-même parce qu’il pense peut-être que son geste aura un impact humoristique ou critique sur la marque. En réalité, il participe à la construction d’une image positive de la marque, capable d’intégrer comme valeur propre la dérision de soi, l’idée de transgression. Cette rhétorique de l’air du temps vise surtout à intégrer et canaliser toute forme de critique. Le principe de récupération fonctionne ici à plein régime en absorbant et en exploitant la critique possible des contenus. C’est toute la question du détournement qui se dépose ici et signe une partie de sa dépossession. La vocation politique du détournement telle que les premiers numéros de L’Internationale Situationniste l’ont décrite a été largement récupérée par le marketing. Les slogans de 68, les structures du happening, rien n’échappe au marketing contemporain. Et les formes de résistance culturelle qui ont pu émerger dès les années 80 connaissent également leurs formes de récupération. Quand l’anti-marketing génère lui-même du marketing, alors ce qui apparaissait comme une forme de dénonciation du système des marques devient un enjeu de consommation et finit par reproduire ce qu’il dénonçait. La critique des marques par leur détournement est aujourd’hui le fruit d’un juteux commerce. Porter un Tee shirt avec une marque détournée est devenu un acte de consommation comme les autres. En ce sens, la vocation critique et politique du détournement disparaît finalement au profit de la marque détournée puisqu’en tant qu’acte de consommation commercial il avalise le système marchand représenté par la marque. Ces actions trouvent leur limite quand on ne sait plus distinguer « le joyeux farceur de l’irréductible révolutionnaire » [7]. Le canular ne se suffit pas pour constituer un acte politique. Les marques l’ont tellement compris qu’elles refusent de s’attaquer au piratage de leurs logos [8]. Ici les choses vont encore plus loin puisque c’est la marque elle-même qui organise et valide ce détournement avec des artistes largement consentants, dans un espace public diffusant le résultat. La pénétration de la marque en dehors de son espace publicitaire classique (le branding comme redéploiement agressif et généralisé des méthodes marketing) dépasse l’attente. Coca Cola n’a même pas ici à faire de sponsoring culturel puisque le musée se charge de diffuser la marque. Non seulement elle valorise son image par cette ouverture pop et chic mais surtout elle garde la maîtrise intégrale de son image et de son héritage.
Cette vieille tactique de l’autoparodie [9] prend ici une dimension particulièrement violente et inquiétante car la pénétration de la marque et la mise en branle de la place de l’artiste touche aussi les formes démocratiques de la société. Cette boîte en est le symptôme.
L’Annonce faite à Coca
C’est le principe même de liberté qui s’efface ici au profit des instances commerciales. L’esthétique cédant le pas à l’industrie culturelle perd sa crédibilité critique et scientifique. En s’aliénant à la finalité promotionnelle, l’espace public s’ébranle et s’effrite.
« En valorisant l’aspect commercial, le sponsoring dévalue simultanément ce qu’il sponsorise… L’événement sportif, la pièce, le concert et l’émission de télévision sont subordonnés à la promotion car, dans l’esprit du sponsor et le symbolisme de l’événement, ils n’ont qu’un rôle promotionnel. Ce n’est pas de l’Art pour l’Art, mais de l’Art pour l’Annonce. Dans l’œil du public, l’art délogé de son domaine distinct, théoriquement autonome, est carrément placé dans le domaine commercial… Chaque fois que le commercial s’immisce dans le culturel, l’intégrité de la sphère publique est affaiblie par cet empiètement de la promotion commerciale. » [10]
Au milieu de tout cela, Delvoye a sans doute cru pouvoir émettre un signe critique alors que l’intrusion publicitaire domine l’ensemble de la démarche.
« Lorsque nous ne pouvons plus répliquer à des entités dotées d’un pouvoir culturel et politique, les fondations mêmes de la liberté d’expression et de la société démocratique sont remise en question. » [11]
C’est bien ce que nous rappelle d’une manière oblique cette rencontre entre un artiste contemporain agitateur, une thématique sulfureuse et un monstre tentaculaire de l’économie mondiale. Au-delà de la vanité consistant à croire que l’on puisse agir contre la marque, cet objet rappelle le rôle neutralisateur du marketing. Sa prolifération dans l’espace public induit l’organisation par elle-même de ces marges de contestation.
Ce symptôme décrit correspond d’une manière plus générale à l’intégration de l’art aux formes d’une culture dépolitisée et marchandisée. Ce que le système désamorce, c’est bien cette part critique inhérente à l’expérience esthétique. Ce que les mécanismes culturels développent et valorisent, c’est le divertissement.
Etymologiquement « détournement » (divertere), le divertissement est une forme d’oubli des dimensions proprement esthétiques liées à l’œuvre d’art. En réduisant les formes de pensée et de création au jeu et à la fausse connivence, la pénétration marchande du monde de l’art avance. Si l’expérience esthétique est un processus critique qui met en place une interrogation dans la fréquentation des œuvres, une réflexion sur elle et sur le jugement, le divertissement [12] n’est qu’une parenthèse et une forme d’oubli de soi pour laisser finalement l’activité marchande décider pour soi.
Pour en revenir à l’essentiel
L’enjeu esthétique et critique de la merde dans l’art se confronte donc aux processus de récupération en marche qui neutralisent le sens de ces questions. Comme le rappelle Marc Jimenez « [ce] nouveau paradigme esthétique ne signifie rien d’autre que la dépolitisation de la sphère de l’art et l’épuration, ou la purification, d’une réflexion esthétique enfin débarrassée de toute trace d’élément critique à l’encontre du social, du politique et de l’idéologie » [13]. Le choix du vocabulaire n’est évidemment pas indifférent dans notre perspective. L’épuration de la langue évoquée par Laporte rejoint la purification de la pensée esthétique dénoncée par Marc Jimenez. Purifiée dans le grand bain baptismal de la marchandisation, « Cloaca-Coca » ne pouvait réussir à élever son geste à une dimension subversive tout simplement parce qu’on ne peut combattre l’aliénation par les moyens de l’aliénation d’une manière aussi frontale qu’explicite.
Sans doute est-ce la raison pour laquelle Wim Delvoye poursuit sa critique des mécanismes publicitaires en se réappropriant les formes inscrites sur la boîte de Coca. Dans une courte vidéo, le Monsieur Propre aux intestins en désordre vante la nouvelle boîte de merde, non sans un humour ravageur. Mais le « Buy Cloaca shit now » ne peut pas faire oublier la rectitude aseptisée de Duchamp et surtout le travail de Manzoni. L’opération de Manzoni est parasitée par celle de Coca Cola, laissant ce curieux, ce désagréable goût dans la bouche.
Coca Caca
Coca Cola, multinationale américaine, défenseur de la famille et du dollar s’est-elle ouverte à une érotique anale ? Désigne-t-elle, dans une posture sadienne, le déchet dans notre bouche… ?
« Cloaca-Coca », petit exercice de coprophagie ?
Evidemment non.
Le Enjoy de Coca-Cola officie une fausse sublimation, et offre en partage un nouvel espace policé et maîtrisé, celui du plaisir de la consommation.
Tout devenir déchet est lavé par la publicité et le dispositif marketing. Transformer la merde en or ! C’est le vieux rêve alchimique (transformé par Manzoni). Mais ici la transmutation ne se réalise pas. Elle se déréalise : c’est cette fausse sublimation. L’œuvre au rouge, stade ultime de l’expérience alchimique tombe bien bas dans les couleurs de Coca Cola. Les bulles n’ont aucunement l’ivresse de la connaissance, juste le goût un peu amère d’une nouvelle encyclique internationale.
En neutralisant les images qu’elle aseptise, Coca poursuit cette entreprise idéologique et commerciale en désimpliquant tout exercice critique, tout acte de pensée. Le rire scatologique n’est ici qu’une forme ludique de reconnaissance d’un connu iconique. La machine publicitaire neutralise la forme artistique.
Enjoy s’est traduit en français par le très sibyllin « sourire la vie », symptôme d’une nouvelle désémantisation neutralisante du langage. En réduisant la langue au slogan, Coca désapprend le langage. Il est recouvert par la consommation. Intransitif ou transitif indirect, le verbe sourire ne saurait être transitif direct comme le publiciste, nouveau prédicateur linguistique, semble le (faire) croire. Un nouvel habitus de langage émerge dans ce contexte général : la perte de la question et de l’interrogation. La légitimation n’est plus celle du sens mais mais d’une signification identifiée à son immédiateté.
Que reste-t-il de nos amours ?
Dans ces périodes où la publicité a envahi l’ensemble de l’espace public, où l’activisme politique et culturel se réduit trop souvent au barbouillage salvateur d’affiches publicitaires, il est nécessaire de retrouver le sens d’une rupture, celui d’un dissensus s’opérant dans et par la pensée. L’enregistrement amusé de la neutralisation de l’art par le libéralisme doit être retournée, renversée. Car cette duplication aseptisée du monde est une fausse identité qui se présente comme réelle. La standardisation parodique est devenue la condition du marché. La valeur d’échange, forme du divertissement, remplace la valeur d’usage. C’est ce fétichisme iconique qui annule les formes de pensée en promettant le bonheur dans l’immédiateté d’un temps éternellement présent.
Reste la merde.
Celle de Manzoni qui n’en finit pas de résonner, inscrite dans une pensée de l’art et du corps.
Celle de Gasiorowski, explorateur limite de la conscience et de ce qu’est être peintre.
Reste la pensée qui ouvre des espaces d’incertitude.
Une pensé qui, dialectique, pense l’esthétique comme forme critique de la pensée contre les formes de la domination et de l’aliénation de la pensée et de l’art dans des systèmes organisateurs qui interdisent le mouvement. Contre l’instance totalisatrice de l’uniformité, la logique de l’œuvre doit refuser, se refuser à son absorption dans le jeu de l’industrie culturelle. Et l’on peut sans doute préférer un rire qui refuse les formes de la conciliation conduisant au curieux consensus de la consommation en forme d’horizon d’attente.
Contre les rationalités instrumentales, une rationalité esthétique qui pose et nourrisse un paradoxe et un conflit : une expérience du monde et une forme de résistance aux effectivités qui ont toujours une vocation de mise en ordre… en contradiction avec un rire scatologique.
[1] Vittorio Sgarbi, ministre berlusconien de la culture en 2002, avait dénoncé l’art contemporain d’« art excrémentiel », le centre Luigi Pecci de « déchetterie de l’art contemporain » et largement dénoncé les œuvres de Duchamp ou de Manzoni.
[2] En 2003, au musée d’art contemporain de Lyon, la machine Cloaca a été alimentée par un menu composé par quelques grands chefs de la restauration française.
[3] Breton, Philippe, La parole manipulée, Paris, La Découverte/Poche, 2000, page 55.
[4] Rochlitz, Rainer, Feu la critique, Bruxelles, La Lettre volée, 2002, page 99.
[5] Rochlitz, Ibidem, page 115.
[6] Klein, Naomie, No Logo, la tyrannie des marques, traduit de l’anglais par Michel Saint-Germain, Paris, Babel-Actes Sud, 2002, page 56.
[7] Ibidem, page 428.
[8] D’autres vont même jusqu’à cesser d’empêcher le vol à l’étalage de leurs produits pour laisser la marque se diffuser et être visible.
Naomie Klein, Ibidem, page 129.
[9] « En 1934, les publicitaires commencèrent à utiliser l’autoparodie pour faire face au crescendo de critique, tactique dans laquelle certains virent une preuve du délabrement de l’industrie. »
Ibidem, page 461.
[10] Matthew McAllister (critique de publicité), cité par Naomie Klein, No Logo, Ibidem, page 69.
[11] Naomie Klein, Ibidem, page 287.
[12] Pour Pascal, le divertissement est d’une manière générale toute activité aveuglant l’homme sur sa condition humaine (mortelle et misérable). Pour lui, le divertissement est cet aveuglement qui nous fait échapper à notre condition humaine. Donc il le condamne car le divertissement engendre illusion et ignorance : illusion de notre condition tragique, ignorance de nos propres motivations (conscience de soi) et de notre rapport au monde. Le bonheur réduit à la reproduction de nos désirs et à la seule possession d’objets (nécessairement insatisfaisants) est cette aliénation de la conscience à l’illusion.
" La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et pourtant, c’est la plus grande de nos misères ; car c’est cela qui nous empêche principalement de songer à nous, et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela nous serions dans l’ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d’en sortir ; mais le divertissement nous amuse, et il nous fait arriver insensiblement à la mort." Pascal, Pensées, II (Misère de l’homme sans Dieu), 170 [79].
[13] Marc Jimenez, entretien avec Jean-Marc Lachaud, Mouvement, numéro 9 Juillet-septembre 2000, page 92.
