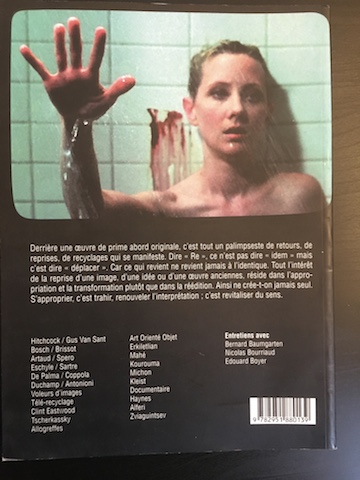Accueil > Articles > 2005 > Psycho à l’épreuve du remake (le bel échec de Gus Van Sant)
Psycho à l’épreuve du remake (le bel échec de Gus Van Sant)
vendredi 3 décembre 2021, par
J’avais tout simplement envoyé une proposition de texte en répondant à l’appel à contribution. La Voix du regard était une grande et belle revue, dense et ouverte... tellement ouverte qu’ils ont accepté mon texte. C’est Anna Guilló que je croisais de temps à autres qui me l’avait annoncé. Elle s’était étonné de mon envoi direct via l’appel à contribution. Je ne voulais pas la mettre mal à l’aise s’il avait fallu le refuser. Le texte a paru... et en très belle compagnie. Et quand on retourne le volume, la quatrième de couverture est une sorte de clin d’œil personnel.
Toujours est-il que ce texte appartient également à une autre époque. Mon regard sur le film de Gus Van Sant a beaucoup évolué. Je m’en suis expliqué et l’on retrouve les éléments de cette réévaluation dans mon livre sur Hitchcock Alma a adoré. Mais comme j’ai décidé de le faire, voici le texte initialement paru en 2005, sans ajout ni modification.

(le bel échec de Gus Van Sant)
L’industrie cinématographique développe largement de vastes stratégies de recyclage des images. Le remake est (souvent) un de ces mécanismes esthétique et commercial d’effacement d’une œuvre antérieure par un appauvrissement et une indifférence progressive du regard. L’instrumentalisation de l’acte mimétique, contrariant les circulations d’influences, fige le spectateur dans l’immédiateté d’une simple consommation. Cette logique commerciale de programmation des regards induit un basculement du sens dans le signe. L’image cinématographique, réduite au simple signe de la circulation marchande, implique moins un enjeu de connaissance ou d’expérience esthétique qu’une fonction de reconnaissance.
L’horizon de ces images est donc celui d’une reconnaissance consensuelle du connu et d’une consommation du toujours-semblable. Les sorties hebdomadaires nous invitent immanquablement à voir de tels films et à comprendre avec eux les enjeux idéologiques, économiques et esthétiques des mécanismes de l’industrie culturelle. Bien sûr, on trouvera toujours quelques exemples fameux permettant de tempérer cette approche sévère. Et c’est justement dans les marges de ces mécanismes que l’on voudrait envisager l’expérience de Gus Van Sant avec Psycho.
Psycho est un film d’Alfred Hitchcock qui a marqué l’évolution du cinéma hollywoodien et celle de nombreux réalisateurs. Plus généralement, l’œuvre d’Hitchcock exerce une très forte influence car elle se construit sur une incessante interrogation de l’image et sur une capacité à produire ses propres marques de contestation de la représentation. De Brian de Palma à Dominik Moll en passant par Dario Argento, Chabrol, Truffaut ou de nombreux autres cinéastes, tous se sont confrontés à cette influence. Gus Van Sant tient une place aussi particulière qu’étrange dans ce panthéon. Cinéaste américain né en 1952, il a longtemps travaillé dans un circuit cinématographique indépendant. Psycho est l’occasion de se confronter à une forme particulière de circulation et de recyclage des images. En effet, le réalisateur de My Own Private Idaho (1991, USA) a conçu un étonnant remake du film d’Hitchcock en tentant de se confronter à la répétition normative du remake et en cherchant à contrarier cette forme réificatrice… au cœur même du remake. Son projet ? Envisager à partir d’Hitchcock une image qui ne re-ferait rien et qui quitterait l’ordinaire de la duplication pour ouvrir un véritable processus créatif à partir d’un matériau cinématographique : Psycho.
Il ne s’agissait pas pour Gus Van Sant de simplement refaire au sens le plus commun des productions hollywoodiennes le Psycho de 1960 tourné en noir et blanc. Gus Van Sant a voulu tourner en couleurs les mêmes plans avec des comédiens contemporains. Ce projet se situe entre deux autres films de Gus Van Sant qui se font écho : Good Will Hunting (Will Hunting, 1997, USA) et la variation sur thème Finding Forrester (A la rencontre de Forrester, 2001, USA, film que l’on peut par ailleurs étudier en référence à la construction spatiale de Fenêtre sur cour). Ce cinéaste est donc attentif à un processus de duplication envisagé comme une forme d’expérience. Mais il y a une contradiction surprenante entre l’audace du projet, la finalité avouée du réalisateur et les mécanismes du remake. Gus Van Sant a voulu se confronter au remake en cherchant une solution artistique et pas seulement commerciale. En voulant travailler sur un aller et retour, il a cherché à trouver une nouvelle interaction avec un public habitué au flux.
L’étude du générique des deux films est assez significative. Si Gus Van Sant reprend la typographie et la construction du générique hitchcockien, c’est évidemment la couleur (le vert) qui vient ici marquer une différence. On constate également que la musique de Bernard Herrmann (adaptée par Dany Elfman) est plus rythmée, légèrement accélérée pour l’oreille contemporaine. Mais ce jeu des sept erreurs serait vain s’il ne signifiait pas un affadissement de l’œuvre originale au profit d’une forme contemporaine codée qui annule les enjeux hitchcockiens.
Les premiers plans de la séquence initiale des deux films permettent de prolonger ces remarques. Pyscho d’Hitchcock s’ouvre sur trois plans menant à une chambre d’hôtel dans laquelle deux amants semblent se rhabiller. Par un plan unique, le début de la première séquence du film de Gus Van Sant passe de la description de la ville à la chambre. Au-delà des différences qui existent, c’est l’évidement esthétique qu’elles contiennent qui doit être interrogé. Le panoramique descriptif (la ville de Phoenix, 1960) est poursuivi chez Hitchcock, après un léger travelling, par un fondu enchaîné sur une façade d’hôtel, puis un plan rapproché sur une fenêtre dans laquelle on entre pour y voir des amants à demi vêtus. C’est la structure inversée de Rear Window (Fenêtre sur cour, 1954, USA). Le film de 1954 commençait par un travelling sortant par une fenêtre pour décrire le décor. Psycho procède par antithèse en se concentrant sur l’univers intérieur. Le lien évident entre les deux films est posé par le dialogue entre Marion Crane et son amant : la question du mariage qui les occupe est également la pierre angulaire de Rear Window (de Jeffries à Lisa en passant par Thorwald l’assassin). Par ailleurs, le souvenir érotique du soutien-gorge (la jeune danseuse que l’on voit au début de Fenêtre sur cour mettre de dos son soutien-gorge) devient dans Psycho un détail structurant et symbolique. Du soutien-gorge blanc de départ au soutien-gorge noir ou sombre qu’elle met après le vol, les changements de sous-vêtements désignent un état intérieur et permettent de penser une véritable « morale » du soutien-gorge chez Hitchcock. C’est avec le meurtre dans la salle de bain qu’Hitchcock fait vaciller cette structure. Marion Crane (interprétée par Janet Leigh) va se doucher après avoir décidé de réparer son erreur, son « égarement ». La voleuse, qui n’avait pas noté son véritable nom sur le registre du motel Bates, reprend son identité au cours de la conversation qu’elle a avec le jeune Bates (interprété par Anthony Perkins). Elle dit son vrai nom au moment où elle envisage de se ressaisir. Elle décide de retourner dès le lendemain rendre l’argent qu’elle a volé. Puis, avant de se coucher, elle va se doucher et se laver d’une journée de profonde confusion. Elle retire ses vêtements et son soutien-gorge. Elle se dirige dans la salle de bain. Le blanc de la faïence et la nudité saturent la séquence d’un retour de la virginité ou plus exactement d’une contrition. Il s’agit de se laver pour faire amende honorable et pour retrouver un chemin moins tortueux que le vol et la fuite. Mais elle est regardée. Sans le savoir, Marion Crane a pénétré l’univers intérieur de Norman Bates, annulant finalement la tentative désespérée d’un retour en arrière et d’un pardon.
La première séquence du film de Gus Van Sant efface ces aspects en concentrant ses intentions sur la forme et en littéralisant le film de 1960. Il opère par des effets d’insistance, préférant l’époque contemporaine et ses clichés à l’œuvre d’Hitchcock. Outre la fluidité linéaire du plan de départ, il faut évoquer la dissipation des enjeux érotiques : l’érotisme hitchcockien est remplacé par une série de gros plans neutralisant le possible érotique, réduit à un plan américain montrant les fesses de l’amant de Marion Crane. L’esthétique publicitaire à laquelle cède Gus Van Sant dénoue les enjeux de la version originale en la pastichant. Par ailleurs, divers effets d’insistance visuels (un très gros plan sur une mouche, détail quasi pictural d’un plan du plateau-repas) ou sonores (le fond sonore – grincements de lits, râles – insistant sur l’hôtel de passe et sur la situation du couple) soulignent cet aspect littéral de la construction filmique. Gus Van Sant choisit de filmer par hélicoptère la prise de vue initiale car, selon lui, Hitchcock n’avait pu le faire pour des raisons techniques. Cette convocation de l’argument technique est une des figures de la justification du remake. Mais en palliant l’impossibilité de l’époque, Gus Van Sant efface l’invention hitchcockienne. Car l’incipit d’Hitchcock s’inscrit pleinement dans une écriture filmique articulée à l’ensemble de ses films (notamment Rear Window). Elle est ici neutralisée par l’effet de contemporanéité qui contredit la teneur de vérité du matériau de l’époque. Gus Van Sant le comprend par la suite.
Ce film me posait le problème de l’appropriation : prendre quelque chose en l’état de quelqu’un, et le faire mien ; m’approprier un film d’Hitchcock, un de mes films préférés, en faire une copie. Ça aussi je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Quand je dis que la copie ne marche pas, c’est qu’elle n’est pas aussi vibrante que l’original. J’ai pu comprendre en cours de route les différences profondes entre le travail d’Hitch et le mien : il y a quelques points communs, et des abîmes d’un autre côté. Le principal fossé tient à la relation aux personnages : lui en fait des objets soumis à une énorme tension, toujours croissante. Le public, alors, entre dans un rapport d’intensité à distance avec les personnages. Dans mes films, au contraire, c’est comme si je devenais moi-même le personnage, et le public s’identifie à lui de manière différente. Mêler ce regard sur les personnages, le mien, avec un autre genre de mise en scène, celle d’Hitchcock, revient presque à « annuler » le film. (1){}
C’est pourtant la couleur qui reste un enjeu essentiel de la version de Gus Vant Sant. L’idée n’est pas celle d’une colorisation arbitraire de la version originale mais d’un travail de saturation de cette couleur jusqu’au patchwork (la chambre de Marion filmée par Gus Van Sant est de ce point de vue exemplaire). Anna Heche qui reprend le rôle de Marion Crane après Janet Leigh, apparaît également à l’écran en sous-vêtements. Mais le choix de couleur vient annuler les inventions hitchcockiennes. Le soutien-gorge est orange, la culotte est fuchsia. La robe et sa veste sont d’un rose éclatant au début du film. Après le vol, Crane-Heche porte des sous-vêtements verts, annulant l’argument « moral » développé par Hitchcock. Gus Van Sant, par cette saturation de couleur, s’inspire ouvertement du travail et de la démarche de Warhol (les multiples des sérigraphies et les jeux de couleurs…).
Si on peut trouver le résultat décevant, cette forme d’appropriation n’efface objectivement pas l’image de 1960, mais elle en neutralise le sens dans le film de 1999. L’application cinématographique de l’interrogation Pop de l’image publicitaire ou culturelle montre au contraire la résistance de l’œuvre cinématographique. Psycho (1999) est un film difficile à voir car il est crypté et raturé par des images qui ne lui appartiennent pas. Ne réussissant pas à instaurer une autre image (la conversion mimétique de départ), le film de Gus Van Sant n’efface pas le souvenir de l’original et objective une « forme d’impuissance ». Le film reste prisonnier d’une esthétique de la photocopie iconique héritée de Warhol et ne réussit pas à défaire les mécanismes liés au remake.
Psycho d’Hitchcock semble donc résister à une assignation à disparaître ou à sagement devenir une strate de l’archéologie cinématographique recyclée dans l’effacement général de la mécanique de l’industrie culturelle. Gus Van Sant s’est confronté au matériau filmique d’Hitchcock en pensant avoir affaire à une matière stabilisée par l’histoire du cinéma. L’expérience du réalisateur d’Elephant ne semble pas venir à bout du film d’Hitchcock. Ce n’était d’ailleurs pas son projet. C’est en revanche celui qui détermine les mécanismes du remake. Le Psycho de Gus Van Sant plonge dans cette contradiction sans parvenir à la surmonter et devient une sorte de film fantôme, un film toujours déjà là, une fausse présence hantée par la mémoire d’un autre, d’un non vécu. Il y a donc un effet d’effacement qui se met en place avec le film de 1999.
L’effacement est par exemple nettement perceptible avec l’emblématique séquence de la douche. Alors qu’en 1960, Hitchcock, utilisait un rideau simplement opaque qui dessinait l’ombre du tueur travesti s’avançant, la version de 1999 s’appuie sur un procédé qui supprime l’effet hitchcockien. Le rideau utilisé par la mise en scène de Gus Van Sant dessine un kaléidoscope et forme une diffraction de l’ombre. L’image, connue et attendue, n’a plus besoin d’être présente. Citée dans son effacement, elle devient une variation oublieuse et méconnaissable. Là où l’ombre induisait une tension, la fragmentation la disloque pour créer un unique effet de surprise. La construction filmique du meurtre est elle-même dévoyée malgré l’intention de loyauté du réalisateur contemporain. Gus Van Sant semble beaucoup plus se souvenir des influences hitchcockiennes sur Dario Argento que d’Hitchcock lui-même. Le sang surajouté, le travail sur le ralenti, l’image heurtée et les plans symboliques de ciels nuageux et tourmentés désignent l’esthétique du réalisateur italien, non celle du metteur en scène anglo-saxon. Par ailleurs, la contre-plongée ajoutée (qui reprend et prolonge la contre-plongée hitchcockienne depuis la pomme de douche) soulignant l’agonie de Marion, participe de la littéralisation. Gus Van Sant évoque d’ailleurs avec une grande acuité cette conscience d’une répétition normalisatrice induite par le remake
Si mon Psycho avait été un triomphe commercial, alors les studios auraient vu exaucé leur désir profond : trouver la bonne recette, établir la formule du succès qui permette de refaire toujours le même film et remporter toujours le même triomphe. D’une certaine manière, tourner Psycho était une blague (practical joke) faite aux studios pour leur démontrer par l’absurde la nature de leur désir profond. (2)
Avec l’échec de Psycho, Gus Van Sant a rendu plus visible encore les mécanismes de la neutralisation commerciale et idéologique du travail artistique. Il est aujourd’hui proprement ironique de voir que, se retirant du système hollywoodien pour retrouver sa ville de Portland et une certaine forme de liberté esthétique, Gus Vant Sant a d’abord réalisé Gerry (2002, USA), un film profondément abstrait, puis Elephant, un film produit par (et initialement pour) la chaîne de télévision américaine HBO, œuvre qui a remporté une palme d’or au festival de Cannes en 2003.
Psycho de Van Sant demeure donc une œuvre singulière et mal aisée, pétrie jusqu’à l’immobilité de ses propres contradictions : ni remake, ni faux remake, il est un entre-deux du film conduisant à penser l’impossibilité du remake au sens strict. Peut-être est-ce la contradiction entre une démarche artistique exigeante et des impératifs économiques (et idéologiques) qui conduit Gus Van Sant dans une telle impasse. Envisager l’image fantomatique du remake de Psycho, c’est renvoyer le film de Gus Van Sant à un statut de spectre, c’est-à-dire un film d’une crise narcissique et d’une régression du regard à un toujours déjà-vu absorbant et impliquant l’absence de toute distanciation et de toute latéralité. Jean Lauxerois rappelle que la crise narcissique est un danger de la culture (3) car elle constitue, à partir d’une séparation du monde ou d’un repli, un enferment dans l’identique. Psycho de Gus Van Sant est un remake qui reproduit le même sans jamais pouvoir explorer sa propre différence. Il n’est pas capable d’entrer dans les latéralités hitchcockiennes car la littéralisation implique un effacement des subtilités pour une évidence programmatique du regard. En ce sens, l’ajout explicite par Gus Vant Sant de la masturbation de Bates regardant par le trou du mur Marion Crane se déshabiller est doublement significatif. Le sous-entendu hitchcockien est littéralisé. Cet ajout caractéristique souligne l’absence de distanciation face au sujet. D’autre part, cette prothèse cinématographique, si elle évoque un enjeu du film d’Hitchcock (la violence narcissique), se retourne et se disloque dans la forme même du film de Gus Van Sant par un épuisant trait épaissi. L’espace mental développé à partir de l’organisation de l’espace chez Hitchcock s’explicite dans la mise en scène de Gus Van Sant pour n’être qu’une instance de reconnaissance du connu. Ce qui pourrait faire différence n’est donc là que pour produire une normalisation.
Peut-être l’échec de Gus Van Sant était-il déjà inscrit dans le film d’Hitchcock. Psycho, l’autre grand film du voyeurisme après Rear Window, est également un film sur les faussaires. Marion Crane, avant d’être assassinée sous sa douche, n’est-elle pas dans la fausseté, le mensonge, le vol, malgré son désir de rédemption ? La schizophrénie de Norman Bates le conduit d’une fausse identité à une identité multiple. Le faussaire qui veut refaire sa mère s’abîme dans un puits sans fond comme un remake de Psycho échouerait à émerger.
Quelques mots tout de même de l’art contemporain où l’on trouve un travail et une réflexion particulièrement dense sur ces enjeux autour Psycho et d’un matériau cinématographique. C’est peut-être l’artiste contemporain Douglas Gordon, et sa vidéo 24 hour Psycho, qui nous apprend par un travail de ralenti à dilater le visible et le temps de l’image cinématographique en renversant paradoxalement la littéralisation. En 1993, sur un écran (3x4 m) suspendu au plafond et visible des deux côtés de la surface, on pouvait voir une projection particulière de Psycho d’Hitchcock. La projection dure 24 heures et montre le film d’Hitchcock au ralenti et sans aucun son.
Dilater le temps, c’est bien ce que Douglas Gordon fait avec Psycho. L’installation vidéo offre au spectateur un autre rapport à l’œuvre d’Hitchcock mais aussi à l’image ainsi qu’à l’espace et au temps de projection. Douglas Gordon fragmente la totalité par la totalité, réussissant le tour de force de contraindre la linéarité cinématographique sans pour autant l’anéantir. Il ne s’agit plus de voir la totalité linéaire d’une histoire, mais de voir l’image par une fragmentation temporelle qui contrarie le flux et l’immédiateté grâce à cet étirement. Alors que l’on envisageait une disparition de l’image dans le film de Gus Van Sant, tant elle était saturée par le film d’Hitchcock, on peut penser qu’elle apparaît au contraire dans le film de Douglas Gordon. Car ce que le cinéma n’investit pas assez, c’est le nouveau rapport à l’image, imaginé par l’art contemporain. Douglas Gordon ne rend pas lisible l’image, il la rend visible dans l’écart même qu’elle produit dans sa réception. En déjouant la logique d’analyse du cinématographique, il donne une autre appréhension du film et de son image, ainsi que de l’image comme instance de l’art contemporain et de l’espace dans lequel s’inscrit cet art. Psycho apparaît dans 24 Hour Psycho en laissant entrevoir un impensé. Grâce au ralenti, Douglas Gordon fait douter de la mémoire des images que l’on a. Il met à l’écart toute leçon pour ouvrir sur des effets d’incertitude. Le travail de Gordon apprend à méconnaître.
On pourrait d’autre part soumettre à l’analyse quelques limites formalistes de l’art contemporain dans son rapport au cinéma… et plus particulièrement dans son rapport à Psycho. Avec Christoph Draeger, la transformation d’une circulation de sens devient un procédé de composition. S’il s’approprie des images cinématographiques et semble interroger les phénomènes de reproduction, la littéralisation qui détermine son activité finit par limiter la proposition. En 2003, Christoph Draeger reprend le matériau filmique de Psycho et élabore Schizo. Cette vidéo de 2003 s’appuie sur la célèbre séquence de la douche. Il superpose les images d’Hitchcock en noir et blanc aux images en couleurs de Gus Van Sant. Reposant la question du double et du remake, Christoph Draeger combine les deux images puisque l’une est sensée être la reproduction de l’autre. Si le travail de l’artiste souligne les limites de l’expérience de Gus Van Sant, on peut se demander si la logique de prolongement n’est pas animée par quelque vanité formaliste ou ornementale. Christoph Draeger littéralise la démarche de Gus Van Sant. La superposition ne fait que reposer la question envisagée par Van Sant. Là était, paradoxalement, la grande réussite de l’échec du remake de Psycho : envisager un double questionnement sur l’image et sur le cinématographique. Christoph Draeger semble penser que la superposition des images des deux films prolonge l’interrogation alors qu’elle réduit les dimensions de l’échec de Gus Van Sant. Draeger réduit la démarche artistique à un formalisme vide, ce que Douglas Gordon avait suspendu en introduisant une tension qui impliquait une proximité troublante et un éloignement radical de l’œuvre d’Hitchcock. L’épuisement de la création que semble revendiquer le travail de Draeger se perd pourtant dans le procédé d’une superposition devenant son unique enjeu. Les surfaces d’images combinées de Draeger évoquent une tendance artiste contemporaine pour qui la littéralisation la plus stricte tient lieu de mise à distance et de critique… renvoyant peut-être au souvenir mal compris d’un geste duchampien qui ne tiendrait plus compte des enjeux esthétiques en cause. La confrontation formelle d’une séquence (même emblématique) a ensuite été systématisée par Draeger puisqu’en 2004, il présentait Schizo (Redux), version intégrale des deux films superposés. Cette mise en abyme de l’épuisement n’est que le signe entropique supplémentaire d’une transformation d’un principe en procédé de composition. Il reste que cette expression concrète et appliquée de Draeger pour souligner la présence fantômale des images hitchcockiennes dans le film de Gus Van Sant ne dit finalement rien de la teneur idéologique de l’implication formelle. Si ce travail de Draeger ne dit finalement rien de la mécanique idéologique inscrite dans le remake, c’est peut-être parce que sa littéralisation formaliste implique elle-même un appauvrissement.
Malgré les réserves exprimées sur le prolongement stylistique de Christoph Draeger, la richesse et l’importance déterminante du dialogue entre le cinéma et l’art contemporain semblent bien être un espace qui propose une véritable alternative critique aux formes du remake et de la programmation du regard.
(1) Gus Van Sant, « Je suis comme Colombo, je fais semblant de ne pas savoir », entretien avec Olivier Joyard et Jean-Marc Lalanne, in Les Cahiers du cinéma, n° 579, mai 2003, p. 24.
(2) Ibidem, pp. 22-24.
(3) Jean, Lauxerois, De l’art à l’œuvre, Paris, L’Harmattan, collection Esthétiques, 1999, pp. 11-12.