Accueil > Articles > 2018 > La marche de l’Europe (Walter Benjamin et la fin de l’Europe)
La marche de l’Europe (Walter Benjamin et la fin de l’Europe)
samedi 4 décembre 2021, par
A l’occasion d’un numéro spécial de la revue Po&sie sur l’Europe (devenu un double numéro), Michel Deguy m’a proposé de participer en se demandant si je ne pourrais pas revenir sur des éléments de mon livre sur Benjamin, Les désordres du monde. Voici donc la proposition que j’ai faite à Michel. Il a fallu couper. Voici donc la version longue de ce texte paru en 2018 dans l’importante revue Po&sie.
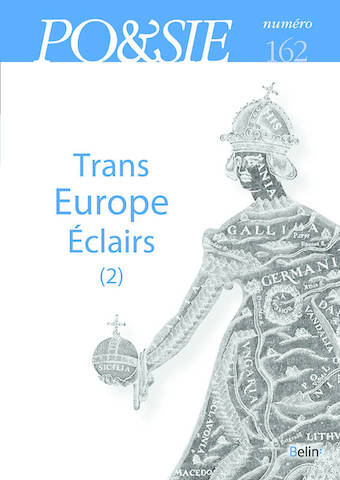
Benjamin et la fin de l’Europe [1]
Marcher à Königsberg
Dans « Qu’est-ce que les Lumières ? », Emmanuel Kant propose pour un large public un résumé didactique de sa pensée politique. C’est par l’usage de la raison et de l’autonomie du jugement que la liberté individuellement et collective se développent au prix du courage et de la responsabilité. Le premier paragraphe du texte fonctionne comme autant sentences définitives pour circonscrire l’idée des Lumières [2].
Au fil de ce court texte de synthèse, Kant multiplie les comparaisons à l’enfance et les métaphores liées à la marche. La liberté de l’exercice de la raison est équivalent à l’apprentissage de la marche pour un enfant (faire un pas sans la roulette d’enfant où ils [les tuteurs] les avaient emprisonnés » [3]. Sortir de la tutelle, c’est sortir de l’enfance et de l’entrave. Marcher seul, c’est faire face aux dangers de l’incertitude, mais « après quelques chutes, ils finiraient bien par apprendre à marcher. » [4]
Cette liberté du corps et de l’entendement dans la marche, Emmanuel Kant la connaissait bien, lui qui, chaque jour à 17 heures, pratiquait une quasi immuable promenade dans Königsberg. Pourrait-il encore aujourd’hui pratiquer cette diététique de l’esprit marcheur avec la même constance dans cette ville aujourd’hui devenue la très russe Kaliningrad ? Le marcheur des Lumières avait ouvert une voie de pensée de la raison. Peut-être est-ce à Port-Bou que cette Europe s’achève ?
Marcher avec Benjamin
Walter Benjamin a beaucoup marché dans les rues de Berlin, de Paris, de Moscou ou d’ailleurs, en Espagne, en Italie, au Danemark. Il est européen par sa pensée comme par sa marche. Il est européen par ses lectures et par son esprit critique du temps (passé, présent et futur), à l’image de cet ange de l’histoire qui hante toujours nos mémoire et notre pensée [5]. Il est européen par ses incessantes traductions. Il incarne littéralement l’expression de Heinz Wismann : Benjamin est européen parce qu’entre les langues [6].
Il a également arpenté Paris, travaillé le hasard de la marche urbaine pour penser Paris, Baudelaire, et le XIXe siècle. Trouver les traces d’un monde perdu, celui de Baudelaire, est la tâche folle que Benjamin s’est donnée en arrivant dans la capitale française en 1933, au moment de son exil. Outre la Bibliothèque nationale, cette recherche s’est faite dans les rues, et surtout dans ces passages parisiens qui ont marqué un tournant radical de la vie moderne, de la pensée et donc de l’art. Benjamin a marché de ce pas étrange qui était le sien.
De nombreux témoignages rappellent la démarche de Benjamin, entre lenteur et claudication. Hans Sahl l’évoque dans ses souvenirs de prisonnier. Jean Selz, qui a accueilli Benjamin à plusieurs reprises à Ibiza, raconte les promenades avec cet homme à la démarche complexe : une difficulté, une grande lenteur, mais une endurance étonnante. Pourtant, Jean Selz rappelle que la marche empêchait Benjamin de réfléchir [7]. C’est pour cette raison qu’il s’arrêtait aussi longtemps que nécessaire, ce qui rallongeait d’autant la durée de la promenade et participait de son esprit de découverte, de son goût pour le détail. Gershom Scholem parle du pas de Benjamin dès les premières pages du portrait de son ami, évoquant une démarche « très caractéristique : elle était lente et comme tâtonnante, ce qui était sans doute un effet de sa myopie. Il n’aimait pas marcher vite » [8]. La lenteur était son rythme, ponctué de nombreux temps d’arrêt. Mais cette lenteur n’empêche rien, elle semble au contraire une méthode.
La marche même de Benjamin pourrait permettre de comprendre la notion centrale de l’image dialectique [9] qu’il développe pour réfléchir sur Baudelaire et pour penser Paris, capitale du XIXe siècle. C’est une idée complexe qu’il définit comme un moment d’arrêt dans le flux, comme une interruption dans un mouvement historique continu. Ce mouvement et son interruption constituent pour lui une méthode de travail, un regard pour penser le temps et chercher dans les détails du présent les traces du passé, une pensée du « rebrousse-poil » [10], peut-être entièrement inscrite dans la marche du penseur allemand.
Le corps du flâneur est un corps spécifiquement moderne. C’est ce que vivent Baudelaire et Benjamin, un corps en lutte contre son temps. Si le flâneur est au milieu de la foule, il est contre elle. La foule avance en masse vers cette société nouvelle de la marchandise et du corps modelé par la marchandise. Le temps du flâneur, dit Benjamin, est une protestation contre la foule et contre le processus de production. Cette lecture de la modernité baudelairienne provoque une discussion assez âpre entre Benjamin et Adorno.
« Vers 1840, il fut quelque temps de bon ton de promener des tortues dans les passages. Le flâneur se plaisait à suivre le rythme de leur marche. » [11] Le rythme de la marche est bien le rythme d’une existence en lutte contre (la marche de) ce progrès, honni par Baudelaire. La lenteur est une arme du nouveau contre le progrès, de l’art ou de l’esthétique contre la production marchande. Sans doute peut-on y voir, au-delà de toute mystique, la trace d’un sens possible des derniers vers des Fleurs du mal.
Pour Benjamin, l’écriture de Baudelaire tente de résister au mode de vie bourgeois qui se met en place. L’auteur des Fleurs du mal défend la dignité du poète contre une société qui ne lui laisse plus d’espace. Ces transformations écrasent désormais la poésie lyrique. Baudelaire y répond justement par un livre de poésie. Pour Benjamin, c’est un signe d’héroïsme. La solitude du flâneur au milieu de la foule est un acte de révolte, comme la lenteur de la marche à pied. La réflexion de Benjamin sur Baudelaire est une manière de suivre ses traces, d’amplifier certaines de ses intuitions et de faire de la marche poétique une pensée de la ville et des transformations urbaines. À partir de son analyse de la modernité (le passé dans l’actuel, l’antique dans le moderne), Benjamin fonde la méthodologie de l’image dialectique, cette tension temporelle, cette fulgurance qui conserve une image du passé dans le présent. C’est donc une forme de résistance au flux, ou à l’immédiateté de l’événement, un peu comme la marche du flâneur.
Ce que Walter Benjamin opère en marchant, c’est une traversée du temps. Les passages parisiens permettent de retrouver les dynamiques à l’œuvre au cours du XIXe siècle et de tracer dans la lecture de la littérature de l’époque les bouleversements dont hérite le XXe siècle. Qu’il se perde dans les rues de Paris comme son éducation berlinoise le lui a appris, ou qu’il soit à sa table de travail, Benjamin déplie une constellation, opère par montage [12]. Il essaye d’écrire le montage intellectuel et esthétique d’une époque, non pas pour découvrir le mystère d’une création, mais pour donner la mesure de cette époque et pour approcher l’écriture de Baudelaire. Plus que tout autre, Benjamin éprouve dans son corps la matière de sa pensée. Tout se tient intimement chez lui. Analyser Baudelaire et les conditions de pensée du XIXe s’articule à l’enfance de Walter Benjamin. Quand on ouvre Enfance berlinoise, texte écrit entre 1932 et 1933 et publié en feuilleton dans divers journaux les années suivantes, on est frappé du lien immédiat qui s’opère entre le travail intellectuel et les souvenirs intimes (et l’influence directe de Franz Hessel). L’incipit d’Enfance berlinoise est l’arc secret d’une existence intellectuelle : « Ne pas trouver son chemin dans une ville, ça ne signifie pas grand-chose. Mais s’égarer dans une ville comme on s’égare dans une forêt demande toute une éducation. […] Cet art, je l’ai tardivement appris ; il a exaucé le rêve dont les premières traces furent des labyrinthes sur les buvards de mes cahiers. » L’intimité des sensations d’enfance revécues dans l’écriture par Benjamin prépare la pensée de Baudelaire. Le labyrinthe n’est pas un simple motif, mais une idée déterminante pour comprendre Baudelaire : « Le labyrinthe est la patrie de celui qui hésite », avant d’être le cœur même du flâneur : « le labyrinthe, dont l’image est gravée dans le corps même du flâneur » [13].
La marche de l’époque
Benjamin quitte Berlin pour Paris en 1933. Il y aura de nombreux voyages à Barcelone, à Ibiza, au Danemark chez Brecht, ou à San Remo chez son ex-femme. Paris est cependant sa patrie intellectuelle et la Bibliothèque nationale, son foyer. Tous ses travaux se concentrent sur Paris, la littérature et la pensée française. L’idée est posée dès 1927, mais l’exil ouvre le chantier de Paris, capitale du XIXe siècle, et la place accordée à Baudelaire devient considérable.
Benjamin est d’abord un exilé. Il fuit un pays, un monde, une idéologie qui veut le détruire. Walter Benjamin est sur la liste des auteurs juifs recherchés par les nazis. Les listes politiques ne sont pas des fantasmes mais des armes à partir desquelles on traque, on exerce une menace, on tue.
À peine arrivé à Paris, Benjamin écrit à son ami de toujours, Gershom Scholem. Nous sommes le 20 mars 1933. Benjamin est à l’hôtel Istria, rue Campagne-Première. Il renseigne son ami sur sa situation et sur celle de quelques proches. Il évoque l’atmosphère berlinoise et les raisons de cet exil :
« Je doute que tu aies déjà parlé à des gens qui ont quitté l’Allemagne après le 15 mars environ. Par lettre, tu ne pourrais être informé que par des individus particulièrement téméraires. Car écrire de là-bas sans un camouflage soigneux peut devenir très dangereux. Libre, je peux m’exprimer clairement et d’autant plus brièvement. C’est moins la terreur individuelle que la situation culturelle dans son ensemble qui peut donner une idée de ce qui se passe. Pour la première fois, il est difficile de disposer d’informations absolument sûres. Il est hors de doute qu’en de très nombreux cas, des gens ont été tirés la nuit de leur lit et molestés ou assassinés. Mais il y a peut-être plus important encore, bien que plus difficile à éclaircir, c’est le sort des prisonniers. Les bruits les plus terribles circulent à leur sujet, dont la seule chose qu’on puisse dire, c’est que certains se sont révélés faux. Pour le reste, il en est comme toujours dans des époques pareilles : les quelques cas qui ont été exagérés sont peut-être contrebalancés par une foule de cas dont on n’entend jamais parler. » [14]
Walter Benjamin passe les frontières. Il cherche un abri, un lieu où vivre et penser. Il a cru qu’il s’agissait de Paris. Walter Benjamin est pauvre à Paris. Ce n’est pas un simple intellectuel précaire comme on pourrait le dire rapidement aujourd’hui. C’est un exilé vivant dans des conditions parfois misérables. C’est un exilé juif et allemand. Entre 1934 et 1939, Benjamin connaîtra au moins dix-huit déménagements, entre les départs-refuges à l’étranger et les logements de fortune, hôtels ou appartements, dans lesquels rien n’est véritablement possible. Le 20 janvier 1938, Benjamin habite le 10 de la rue Dombasle, dans le 15e arrondissement, c’est sa dernière adresse connue. Il y souffre horriblement du bruit de l’ascenseur à côté de son appartement.
Walter Benjamin ne trouvera jamais sa place dans la vie intellectuelle et éditoriale française, malgré les contacts, malgré ses traductions d’écrivains français, y compris ses contemporains, et malgré la connaissance de son œuvre par certains. Pourtant, malgré tous les désagréments, malgré toutes les portes fermées par indifférence, par mépris, ou par antisémitisme, malgré toutes les violences exercées par l’État français, Walter Benjamin s’accroche à Paris, à Baudelaire et aux passages parisiens. Le 11 janvier 1940, il fait renouveler sa carte de la Bibliothèque nationale. Benjamin s’accroche désespérément au flâneur et à Paris. Contre son époque, et contre la réalité historique qui gronde. Tente-t-il ainsi de sauver les livres et l’écriture des désastres européens ? Il s’arrache du monde, s’enferme à la Bibliothèque nationale justement pour sauver le monde. N’est-il pas alors, marchant inlassablement à la Bibliothèque nationale cet homme libre et autonome, décrit par Kant et qui a tenté d’être, un temps, l’ethos européen ?
{}
Avant de quitter définitivement Paris et son appartement de la rue Dombasle, Benjamin est au plus mal. En 1940, il envoie des lettres à son entourage signalant sa situation, cherchant toujours à tempérer ce qui aurait dû être un cri d’urgence par des propos rassurants sur sa capacité à travailler et à poursuivre ses recherches sur son Baudelaire. Pourtant, ce qui revient dans cette correspondance pour signifier la gravité de son état est lié à la marche, à son incapacité à se déplacer. À Gretel Adorno, il confie, le 17 janvier 1940 : « Depuis qu’un froid intense s’est installé chez nous, je ressens des difficultés extraordinaires pour la marche en plein air. Je suis obligé de m’arrêter toutes les trois ou quatre minutes, en pleine rue. » [15] A Max Horkheimer, le 6 avril 1940, il évoque ouvertement ses soucis de santé : « Ma faiblesse physique a augmenté dans une proportion inquiétante. Il y a des jours où, après avoir fait cent pas dans la rue, je suis en nage et n’en peux plus. » [16]
Les voyages, la pauvreté n’y changent rien. Depuis son arrivée à Paris en 1933, Walter Benjamin se sent chez lui dans la capitale française. Ce n’est pas seulement une patrie d’exil, c’est son cœur intellectuel. Il veut être français parce qu’il est parisien, non pas homme de salons ou de dîners en ville, mais flâneur baudelairien, héritier des passages et de la complexe fragilité de l’écriture et de la pensée.
Mais Paris est une nasse. Benjamin ne le sait pas encore. Il le pressent peut-être, pourtant il revient toujours à Paris. Malgré les appels pressants de ses amis qui lui demandent incessamment de s’éloigner davantage de l’Allemagne de Hitler. Gretel Adorno et son mari le poussent à venir aux États-Unis Asja Lacis l’invite à Moscou et Gershom Scholem, l’ami de toujours, renouvelle ses invitations à le rejoindre à Jérusalem. Même Dora, son ex-femme, lui proposera de la suivre à Londres. Rien n’y fera. Ce sera Paris. Toujours et encore. Pour Benjamin, traducteur de Baudelaire et de Proust, lecteur de ses contemporains français, la France est associée à l’image du pays des exilés. C’est le livre des passages et de la littérature.
Déchéance de nationalité et camps d’internement
Déchu de sa nationalité allemande, le 23 février 1939, il n’obtient pas la nationalité française malgré ses demandes et ses soutiens. Avec l’entrée en guerre de la France, Walter Benjamin appartient désormais à la catégorie des « sujets ennemis » comme tous les Allemands exilés, y compris les plus antifascistes. La propagande de la cinquième colonne a fait son œuvre. Ce sont ces mêmes sujets ennemis qui deviendront bientôt les représentants de l’anti-France. C’est donc le 4 septembre 1939 que Walter Benjamin est interné. Aucun argument n’a porté : sa déchéance de nationalité, sa demande de nationalité… sa carte de la Bibliothèque nationale ! Rien. Il part au stade de Colombes. Il y passera neuf jours dans des conditions d’accueil particulièrement affreuses. On dort sur de la paille pourrie, il n’y a pas de sanitaires dignes de ce nom alors que des milliers de personnes vont passer dans ce camp d’internement. Allemands ayant fui l’oppression nazie, ils sont des milliers à se retrouver parqués dans ce stade. Après guerre, le lieutenant Dubuc, qui supervisait la vie des camps, témoignera que, à la suite des arrestations conduites par la police, les internés ont connu un véritable pillage de leurs biens. Benjamin est arrivé avec sa pauvre valise, retrouvant au milieu des gradins nus du stade quelques connaissances dont Hans Sahl et Heinrich Blücher qui se mariera, le 16 janvier 1940, avec Hannah Arendt, cousine par alliance de Benjamin. Franz Hessel, exilé à Paris parce que Paris était sa seconde patrie, est également enfermé à Colombes.
Benjamin est un homme fatigué, miné par la solitude et les conditions de vie difficiles de l’exil parisien. Il a de sérieux problèmes de cœur et l’environnement du camp n’arrange pas sa santé. Mais le stade de Colombes n’est qu’une étape. Il est mis le 14 septembre dans un bus, conduit à la gare d’Austerlitz et envoyé dans le Nivernais en train plombé. Arrivé de nuit à Nevers, qu’il ne verra pas, il doit supporter deux heures de marche pour rejoindre le château de Vernuche, dans le clos Saint-Joseph, transformé en « camp de travailleurs ». Les malaises se succèdent. Benjamin est très mal en point. L’endroit est vide, les décisions ont été prises dans l’improvisation la plus totale.
La France n’a tiré aucune leçon de l’impréparation dans l’accueil des réfugiés arrivés d’Espagne à partir de février 1939. Alors qu’il avait connaissance de la situation, l’État n’a pas anticipé cette Retirada, pensant l’éviter en fermant simplement les frontières. Le 6 février 1939, la France assouplit les conditions d’entrée : seuls les « hommes jeunes et valides » sont interdits d’entrée au territoire français. Quelque 500 000 Espagnols franchiront néanmoins la frontière pour atterrir dans des camps d’internement particulièrement rudes, malpropres, inconfortables et édifiés à la hâte. Les conditions de vie sont très mauvaises et l’administration militaire violente, menant même une véritable politique de rapatriement (y compris forcé). Les réfugiés espagnols et italiens subiront la même méfiance que les réfugiés allemands. La cinquième colonne est partout. Ces camps de travail, d’internement, de concentration, seront une aubaine pour le vainqueur et l’occupant de 1940. La convention d’armistice avec l’Allemagne spécifie dans l’article 19 que « tous les prisonniers de guerre et prisonniers civils allemands, y compris les prévenus et condamnés qui ont été arrêtés pour des actes commis en faveur du Reich allemand, doivent être remis sans délai aux troupes allemandes ». Une note interministérielle française du 11 juillet 1940 indique que « les autorités italiennes auront le droit de demander la remise de ceux des internés qu’elles se réservent de réclamer au gouvernement français ». Il en sera de même pour les espagnols rouges : au moins 40 000 Espagnols sont recherchés par les Allemands. Sans la moindre protestation de Vichy, ils sont déplacés en Allemagne pendant la guerre. Plus de 8000 sont envoyés dans les camps nazis, notamment Mauthausen.
Au château nivernais où il se trouve dans un certain désœuvrement, Benjamin fait ce qu’il peut, ce qu’il sait faire : il organise des cours de philosophie et envisage la création d’une revue. Elle ne verra pas le jour, car il sera libéré avant. Hans Sahl décrit Benjamin comme un homme qui boite, comme un être qui se heurte à la réalité de l’existence. Face à la violence du réel, il se réfugierait dans la philosophie. Ou peut-être agit-il avec les armes qui sont les siennes, avec le retard, la marche boiteuse qui est une position politique démesurée ? Pourtant, dans les lettres qu’il envoie durant cette période, il ne dit rien de sa situation, de sa vulnérabilité, de la détresse intime qui est aussi celle du temps. Il ne dit rien de la nasse et de la catastrophe qu’il regarde se dévider sous ses yeux, cette catastrophe qu’il vit au milieu de cette machine politique et idéologique dont il est une des victimes.
Même s’il est isolé, Benjamin a encore quelques soutiens qui remuent ciel et terre pour le faire libérer. Adrienne Monnier fait tout ce qu’elle peut, sollicitant Paul Valéry et Paul Desjardins. Le PEN-Club, alors présidé par Jules Romain, s’active en sa faveur auprès des autorités. Il en est de même pour Gisèle Freund, Helen Hessel ou Sylvia Beach (éditrice de Joyce et fondatrice de la librairie Shakespeare et Company). Le diplomate Henri Hoppenot appuie les demandes de libération et Max Horkheimer, depuis les États-Unis, contacte le Congrès juif mondial. Walter Benjamin est libéré le 16 novembre 1939, après deux mois et demi d’incarcération. Il passe dix jours à Meaux, avant de regagner Paris et la Bibliothèque nationale. La catastrophe est en marche et pourtant Benjamin ne part pas. Alors que le National Refugee Service américain semble prêt à examiner une possible émigration, il préfère la bibliothèque parisienne. Il veut achever et sauver son travail sur Baudelaire. Mais il est littéralement épuisé. Le 11 janvier 1940, il fait renouveler sa carte de la Bibliothèque nationale.
Entre 1939 et 1945, la France a compté plus de 225 camps d’internement. Certains, plus terriblement célèbres que d’autres, comme celui de Drancy, servirent de transit pour des milliers de personnes avant les camps d’extermination nazis. Tous ces camps permirent aussi à l’État français, avec ou sans l’aide de l’occupant nazi, d’enfermer des innocents. Ils sont seulement des étrangers, des juifs, des réfugiés, des exilés, des apatrides.
Arthur Koestler a bien connu Walter Benjamin. Ils partageaient un goût commun pour le poker et pour les échecs. Comme avec Brecht, Benjamin aimait ces longs partages immobiles avec Koestler. Les deux hommes se sont retrouvés dans la débâcle marseillaise.
À Paris, Koestler a été arrêté au 10 rue Dombasle. Il était le voisin de Benjamin. L’écrivain est interné au camp du Vernet, un des camps français les plus terribles, où l’insalubrité fait concurrence à la famine rampante et à la boue constante. Koestler décrit un camp « organisé sur le modèle si typique de l’administration française, mélange d’ignominie, de corruption et de laisser-faire ». C’est là qu’il termine la rédaction de son livre Le Zéro et l’Infini. Koestler tire également de cette période un récit implacable sur l’effondrement de la France et sur la violence du camp du Vernet. La Lie de la terre, notamment dédié à Walter Benjamin, se termine sur l’évocation de son ami et sur la tragédie à l’œuvre : « Et la procession du désespoir allait s’allongeant, refluait vers ce dernier port, vers cette bouche béante de l’Europe, qui vomissait le contenu de son estomac empoisonné. » [17]
Ces camps ont disparu aujourd’hui. On essaye de se rappeler leur existence. Il existe cependant, toujours sur le territoire français, des camps de rétention, à la réputation souvent discutée. La France est aujourd’hui un pays qui n’accueille plus les exilés et les réfugiés de guerre. Sans doute est-ce cela, les leçons de l’Histoire.
Le pas du retard
Le retard est donc une inquiétude de la pensée, une entorse aux programmes, aux programmations de toutes sortes. La contre-mesure, c’est le retard c’est-à-dire un contretemps qui dérange les plans et les calculs par un inattendu, un déconcertant, une désorientation de la tradition. La philosophe Françoise Proust pense la temporalité du retard comme un enjeu critique [18]. Le retard devient une forme de résistance à l’immédiateté qui se risque à l’invention. Le retard est alors l’invention d’une distance, mais une distance impliquée. C’est l’invention d’une démarche et d’un pas qui contrarient les marches forcées.
Dans Chroniques berlinoises, Walter Benjamin évoque une marche avec un « demi-pas de retard ». Suivant la voie tracée par Baudelaire, cette marche participe du mouvement critique induit par Benjamin comme renversement de la continuité historique, et même comme action révolutionnaire : « vaincre le capitalisme par la marche à pied » [19]. Ce qui se tisse dans cette marche du demi-pas de retard, c’est le double travail dialectique de la distance et de l’implication. Face à la mise au pas de la pensée, le retard socratique ou benjaminien est une forme d’éloignement pour découvrir failles et brèches, images inédites et critiques, bientôt appelées images dialectiques.
Le philosophe français Jacques Derrida décrit assez bien ce mouvement qui pourrait caractériser le pas de retard benjaminien comme un déplacement autre, une lenteur dont l’autre nom serait le retard. Le point commun est la complexité, un étrange pas d’éloignement, dit encore Derrida : « La lenteur n’est plus tant simplement un certain rapport du temps au mouvement, une moindre vitesse. Elle accomplit, accélère et retarde à la fois infiniment un étrange déplacement du temps, des temps des pas continus et des mouvement enroulés autour d’un axe invisible et sans présence, passant l’un dans l’autre sans rupture, d’un temps dans l’autre, en gardant la distance infinie des moments. » [20]
Ce pas, c’est le substantif qui caractérise la marche au demi-pas de retard, démarche étrange, presque claudicante, celle qui provoque la distance… cette démarche fragile à laquelle on doit, par exemple, de malencontreusement heurter des pavés disjoints, comme chez Proust. Mais ce « pas », c’est aussi l’adverbe, la négation, le travail d’une absence, d’un absentement… une discontinuité du temps, du discours ou du récit. Le retard devient alors suspension de la logique de l’autorité (ce que l’on retrouve chez Socrate, Baudelaire, Flaubert ou Benjamin). C’est une objection qui vient suspendre le sens, l’inquiéter.
La modernité benjaminienne est une radicalisation de la conscience de la perte à partir d’une expérience fragmentaire. Ce qui a lieu, un choc et une impossibilité de saisir désormais les conditions mêmes de l’expérience. Ce qui se saisit, c’est la trace. Quelque chose a eu lieu... mais qui ne se saisit que rétrospectivement. C’est-à-dire après coup.
Le retard figure quasiment le rythme du flâneur, si essentiel à Benjamin pour penser Baudelaire comme écrivain retardataire. La marche servait à Benjamin de contretemps rythmique pour penser l’Histoire. Sans doute est-ce le plus grand héritage que Benjamin reçoit de Franz Hessel. Les deux amis se rencontrent tôt, s’apprécient et travaillent ensemble, notamment à la traduction de Proust dans laquelle Hessel se plonge plus que tout autre. Mais ce que Benjamin apprend de Hessel, c’est cet art de la marche du flâneur qu’on peut lire dès l’incipit de Promenades dans Berlin, qui sera un modèle d’écriture pour Benjamin : « Marcher lentement dans les rues animées procure un plaisir particulier. On est débordé par la hâte des autres. C’est un bain dans le ressac. » [21]
Cependant, les pièges de l’accélération guerrière auront raison de la marche de Benjamin, devenue si lente, par la force des choses. Ou plutôt l’absence de force. L’épuisement de Benjamin, la lenteur de sa fuite, sont les symptômes de l’écroulement de l’Europe. Le corps même de Benjamin concentre cette densité du désastre. Port-Bou est l’épuisement de l’espoir, son retard tragique. Il aurait suffi d’un jour pour que Benjamin traverse la frontière sans encombre et soit sauvé. Il n’en sera rien. Benjamin se suicide après avoir confié ses derniers manuscrits à son entourage, après avoir caché un peu partout en Europe son travail, sa vie éparpillée, fragmentée par les temps meurtriers du nazisme, de l’État français collaborationniste et de l’indifférence de l’Espagne franquiste. Benjamin ne pouvait plus être nulle part. La nasse s’est refermée sur lui et a effacé ses traces et la mémoire de sa mort avant que quelques amis et intellectuels ne rassemblent, dans le retard des vies mutilées, les bribes d’une pensée, l’expérience fragmentaire d’une écriture en parfaite résonance avec son temps, en parfaite résonance avec l’invitation baudelairienne de l’écrivain retardataire.
Benjamin est un homme exténué. L’internement à Colombes, puis à Nevers, a aggravé sa maladie de cœur. Il arrive épuisé et vieilli dans le modeste hôtel Continental du 6 rue Beauvau, près du Vieux-Port. Il retrouve Hannah Arendt et son mari. Il confie à celle-là ses derniers manuscrits et ses envies de suicide. Il rencontre le fils de son ami Franz Hessel avec qui il a traduit Proust en Allemagne et en France. Le jeune Stéphane Hessel se souvient d’un homme abattu, sans espoir pour l’Europe ou pour lui-même. Il retrouve Arthur Koestler avec qui il a partagé des parties d’échecs, rue Dombasle à Paris. À Marseille, il partage ses pilules de morphine. Benjamin est conscient de la nasse, de l’issue possible et probable. Il se souvient de son suicide raté de 1932 et donne pourtant une partie de ses cachets à Koestler. Il lui en reste suffisamment pour lui-même. Il les utilisera fin septembre à Port-Bou. Après sa tentative ratée à Lisbonne, un an plus tard, Arthur Koestler se suicidera en 1983. Il s’ajoute à la longue liste des suicidés de l’Europe : Ernst Weiss, Franz Blei, Walter Hansenclever, Wolfgang Döblin, Carl Einstein, Stefan et Lotte Zweig. Et tant d’autres.
En 1940, le journaliste Varian Fry ouvre le Centre américain de secours, qui vient en aide à de nombreux réfugiés et permettra à plus de 2000 personnes de quitter Marseille. Fin août, grâce à l’Institut de Horkheimer, exilé aux États-Unis, Walter Benjamin obtient un visa pour les USA. Mais il n’a pas l’autorisation de sortie du territoire français. Avec l’instauration de l’État français de Vichy, il est devenu impossible d’obtenir ce visa, surtout si l’on est étranger, juif, allemand déchu de sa nationalité. Benjamin ne se tourne pas vers les filières de Fry. Il tente la voie administrative, mais le blocage complet précipite sa fuite vers les Pyrénées. Le 23 septembre 1940, il décide de suivre un réseau de clandestins passant par l’Espagne. Il rejoint Banyuls-sur-Mer en train. Avec l’aide du maire socialiste de la ville, Vincent Azéma, de nombreux réfugiés fuiront la France via le chemin des crêtes. Cette route dite Lister est étroitement surveillée par la Gestapo, très présente à la frontière. Le 24 septembre, le groupe de Benjamin fait une reconnaissance. Le philosophe est parti avec Lisa Fittko, qui anime une filière de passage de clandestins avec Fry, Henny Gurland et son fils Joseph. Cependant, la montée épuise Benjamin. Il est malade. Tout effort devient quasiment insurmontable. Il décide de ne pas redescendre et d’attendre le groupe le lendemain, s’épargnant un trajet. Mais la nuit, dehors dans la montagne, l’épuise encore plus, rendant l’ascension du 25 particulièrement longue et pénible. Benjamin doit s’arrêter très souvent. Cependant, ils atteignent Port-Bou et se rendent immédiatement au poste-frontière pour obtenir un visa. L’Espagne était jusqu’alors ouverte et accueillante. Le pays de Franco sait que tous rejoignent le Portugal pour aller ensuite aux États-Unis. Or, Ribbentrop a profité d’une visite en Espagne pour demander un durcissement de la politique migratoire espagnole. Au moment où Benjamin arrive en Espagne, les règles ont changé sous la pression du Reich. Le sol espagnol est désormais interdit à quiconque n’a pas un visa de sortie du territoire français. Le groupe est donc arrêté. On leur signifie leur reconduction à la frontière le lendemain. Ils seront remis aux autorités françaises. Le groupe est assigné à l’hôtel Fonda de Francia, sous la surveillance des gendarmes locaux et sous le regard de la Gestapo, qui cache assez peu sa présence à Port-Bou. C’est une nasse. Plus il avance, plus il s’enfonce dans le piège. S’il est remis à la police française, il sait qu’il sera remis officiellement à la Gestapo et exécuté à brève échéance. Quels sont ses moyens de fuite ? Dans la chambre numéro 4, au deuxième étage de cet hôtel situé au 5 avenida del General Mola (aujourd’hui carrer de Mar), Benjamin n’a plus aucune issue. Dans la nuit du 25 septembre, il absorbe ses pilules de morphine. On le découvre agonisant au matin. Les gendarmes affolés appellent un prêtre et un médecin. Le groupe de réfugiés tait les origines juives de Benjamin pour ne pas attirer l’attention sur eux. Un prêtre veille sur le mourant. Le médecin le soigne sans comprendre qu’il s’agit d’un empoisonnement. Intransportable, Benjamin décède dans cet hôtel de Port-Bou à 22 h 35. Le docteur Ramon Vila Moreno délivre le 27 septembre 1940 au matin un certificat de décès. Les gendarmes espagnols, traumatisés par cet événement, laisseront Lisa Fittko, Henny Gurland et son fils Joseph partir. Ils iront au Portugal et finiront par rejoindre les États-Unis. Hannah Arendt s’était enfuie du camp de Gurs, qui allait bientôt livrer ses camarades emprisonnées à l’Allemagne nazie et aux camps d’extermination. Elle avait rejoint Marseille et avait fini, elle aussi, par gagner le Portugal grâce à Fry. À Lisbonne, dans l’attente interminable d’un bateau pour les États-Unis, elle lit et relit le dernier manuscrit de Walter Benjamin, ses « Thèses sur le concept d’histoire ». Elle sauvera donc le texte de la catastrophe européenne.
Hannah Arendt, dans le portrait de Walter Benjamin, décrit simplement ce moment fatal à partir de la politique d’accueil de l’Espagne : « L’embargo sur les visas fut levé quelques semaines plus tard. Un jour plus tôt, Benjamin serait passé sans difficulté ; un jour plus tard, on aurait su à Marseille qu’il n’était pas possible à ce moment de passer en Espagne. C’est seulement ce jour-là que la catastrophe était possible. » [22]
Walter Benjamin meurt à Port-Bou sans aucune nationalité, arrêté par la police espagnole, il sait qu’en tant qu’étranger, juif, métèque allemand déchu de sa nationalité, il sera remis aux autorités nazies. Il sait la catastrophe que regarde l’ange de l’Histoire, celle des Namenlosen [23] Le roman national français est ici, celui d’un visa de sortie refusé par la France d’alors. Refuser de laisser sortir un juif apatride pour mieux l’envoyer ailleurs.
Dans le droit, l’apatride est un point de néant. C’est la bête sauvage et honnie. C’est le monstre de tous les soupçons : on ne peut pas lui faire confiance et on ne peut pas non plus le renvoyer chez lui. C’est une aberration bien embarrassante. Dans le droit romain, cela signifie littéralement ôter la cité, l’apatride est celui que l’on extrait de la cité et de l’idée même de cité.
Paris est un refuge ultime pour Benjamin. Car, après avoir été exilé, on l’a privé de son identité berlinoise, ce qu’anticipe sans doute Benjamin en écrivant, dès 1933, ses souvenirs d’enfance. Mais, à la différence de cet autre marcheur, Nietzsche, qui brandissait dans Le Gai Savoir un « Nous les apatrides » pour dénoncer les idéaux confortables et refuser les nationalismes, Benjamin ne s’est jamais extrait des nations. À rebours d’un certain imaginaire romantique nietzschéen, qui se plaçait au-dessus des nations, Benjamin n’a jamais cessé d’explorer les dessous, les rebuts, les oubliés de l’idéal citoyen ou national. Là où le droit romain bannissait et créait des apatrides pour leur éviter la peine de mort, le régime nazi, dans sa volonté de destruction des juifs d’Europe, poursuit l’apatride Walter Benjamin avec la complicité de l’État français pétainiste.
C’est donc aussi l’histoire d’une déchéance de nationalité que celle de Walter Benjamin. On ne comprend pas bien pourquoi l’État nazi prend ce prétexte de la publication soviétique pour le déchoir, mais, au moment où j’écris ce livre, la société française était traversée par cette question : la déchéance de nationalité. Le contexte est évidemment différent. Nulle comparaison à faire ou à exiger pourtant tout au long des recherches et de l’écriture, ces mots sont revenus, déchéance de nationalité, alors même que je travaillais sur les camps d’internement français, que je me renseignais sur les pratiques et sur le cadre législatif qui entourait l’accueil des étrangers allemands, italiens et espagnols… alors même que j’entendais chaque jour le décompte macabre des morts en mer Méditerranée… alors même que je voyais s’entasser à nos frontières européennes fermées ces autres réfugiés qu’on n’accueillerait pas… depuis 2011, ce sont 10 000 Syriens qui ont été accueillis en France sur 5 millions ayant fui la guerre, les bombes, les massacres… en 2015, il y a eu 5 122 demandes d’asile… la France, terre des exilés et des droits de l’homme, aura vécu… sur le bruit de fond médiatique et politique d’une déchéance de nationalité qu’on aura voulu inscrire dans la Constitution française… pour qui ? pour quoi faire ? Pour quelles dérapages futurs au-delà de l’effet d’annonce opportuniste, irréfléchi et dévastateur ?
Walter Benjamin est un des derniers représentants d’une culture européenne rêvée, comme Zweig qui lui aussi mourra dans un exil lointain. Benjamin est l’homme des livres et de la culture, la française comme l’allemande. À partir de 1933, l’Europe ne croit plus en la culture. Elle commence par brûler les livres, puis les hommes [24]. Une idée de l’Europe s’était ouverte dans les promenades de Königsberg. Elle se referme à Port-Bou dans l’épuisement de la marche et du monde. Après 1945, l’Europe ne croit plus en la culture, elle ne croira plus dans les livres, les langues ou la culture. Elle se met à croire en l’économie, sa main invisible. Elle croit au marché. C’est l’horizon, peut-être, le seul désormais. L’Europe qui s’invente sur les décombres de la guerre a trop vite oublié les livres et la pensée pour le seul libéralisme des marchandises et des profits.
En attendant de trouver un demi-pas de retard pour l’Europre…
« La rue conduit celui qui flâne vers un passé révolu. Pour lui, chaque rue est en pente, et mène, sinon vers les Mères, du moins dans un passé qui peut être d’autant plus envoûtant qu’il n’est pas son propre passé, son passé privé. Pourtant, ce passé demeure toujours le temps d’une enfance. Mais pourquoi celui de la vie qu’il a vécue ? Ses pas éveillent un écho étonnant dans l’asphalte sur lequel il marche. La lumière du gaz qui tombe sur le carrelage éclaire d’une lumière équivoque ce double de soi. »
Walter Benjamin, Paris, Capitale du XIXe siècle (p. 434)
[1] Des éléments de cet article sont empruntés à mon livre Les désordres du monde. Walter Benjamin à Port-Bou, Paris, Pauvert, septembre 2017.
[2] Un« Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude ! Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen ! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. »
« Les Lumières, c’est la sortie de l’homme hors de l’état de tutelle dont il est lui-même responsable. L’état de tutelle est l’incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d’un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de la résolution et du courage de s’en servir sans la conduite d’un autre. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Voilà la devise des Lumières. » Emmanuel Kant, « Réponse à la question : qu’est-ce que les Lumières ? », in Vers la paix perpétuelle, traduit de l’allemand par Jean-François Poirier et Françoise Proust, Paris, GF-Flammarion, 1991, p. 43.
[3] Emmanuel Kant, « Réponse à la question : qu’est-ce que les Lumières ? », Op. Cit., p. 44.
[4] Ibidem.
[5] « Il existe un tableau de Klee qui s’intitule " Angelus Novus". Il représente un ange qui semble sur le point de s’éloigner de quelque chose qu’il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C’est à cela que doit ressembler l’ange de l’histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d’événements, il ne voit, lui, qu’une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si violemment que l’ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s’élève jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. »
Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », in Œuvres III, traduction Maurice de Gandillac, Pierre Rusch et Rainer Rochlitz, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2000, p. 434.
[6] Heinz Wismann, Penser entre les langues, Paris, Albin Michel, 2012.
[7] « Benjamin marchait avec une certaine difficulté et il ne marchait pas vite mais il était capable de marcher longtemps. Les longues promenades que nous faisions ensemble à travers la campagne vallonnée, plantée d’amandiers, de caroubiers et de thuyas, étaient rendus plus longues encore par nos conversations qui l’obligeaient constamment à s’arrêter. Il avouait que marcher l’empêchait de réfléchir. » Jean Selz, « Walter Benjamin à Ibiza », in Écrits français, Paris, Gallimard, 1997, p. 369.
[8] Gershom Scholem, Walter Benjamin. Histoire d’une amitié, traduit par Paul Kessler, Paris, Calmann-Lévy, 1981, 17.
[9] « La marque historique des images n’indique pas seulement qu’elles appartiennent à une époque déterminée, elle indique surtout qu’elles ne parviennent à la lisibilité qu’à une époque déterminée. Et le fait de parvenir « à la lisibilité » représente certes un point critique déterminé dans le mouvement qui les anime. Chaque présent est déterminé par les images qui sont synchrones avec lui ; chaque Maintenant est le Maintenant d’une connaissabilité déterminée. Avec lui, la vérité est chargée de temps jusqu’à en exploser. (Cette explosion, et rien d’autre, est la mort de l’intentio, qui coïncide avec la naissance du véritable temps historique, du temps de la vérité.) Il ne faut pas dire que le passé éclaire le présent ou que le présent éclaire le passé. Une image, au contraire, est ce en quoi l’Autrefois rencontre le Maintenant dans un éclair pour former une constellation. En d’autres termes : l’image est la dialectique à l’arrêt. Car, tandis que [l]a relation du présent au le passé est purement temporelle, la relation de l’Autrefois avec le Maintenant est dialectique : elle n’est pas de nature temporelle, mais de nature figurative (bildlich). Seules les images dialectiques sont des images authentiquement historiques, c’est-à-dire non archaïques. L’image qui est lue — je veux dire l’image dans le Maintenant de la connaissabilité — porte haut plus haut degré la marque du moment critique, périlleux, qui est au fond de toute lecture. » Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, traduction Jean Lacoste, Paris, Cerf, 2002, pages 479-480.
[10] Georges Didi Huberman, Devant le temps, Minuit, 2000, p. 103.
L’image dialectique est une image historique reposant sur une temporalité complexe et une ambiguïté. C’est en cela qu’elle est périlleuse. Elle renonce à toute forme d’univocité. En instaurant un nouveau rapport entre un passé interrompt et un présent qui n’exclut pas pour autant ce passé dans son propre mouvement, l’image dialectique ouvre une saisie intense qui interrompu un mouvement spontanée et enclenche un processus complexe. Avec l’image dialectique, les choses ne vont plus de soi. Elle engage un mouvement critique qui interrompt le flux et constitue un décalage, une oblicité. L’écart qui s’ouvre contre « l’habitus » est le moment du dépliement critique. Le mouvement qui se crée est dynamique mais ne se réduit pas à la linéarité puisqu’il saisit ce passé lointain presque interdit dans un présent. C’est dans ce mouvement constitué comme forme de mémoire que le positivisme historique est ruiné et cède la place à cette nouvelle dynamique.
« La « révolution copernicienne » de l’histoire, écrit Georges Didi Huberman, aura donc consisté, chez Benjamin, à passer du point de vue du passé comme fait objectif à celui du passé comme fait de mémoire, c’est-à-dire comme fait en mouvement, fait psychique aussi bien que matériel. La nouveauté radicale de cette conception – et de cette pratique – de l’histoire, c’est qu’elle part, non des faits passés « eux-mêmes », cette illusion théorique, mais du mouvement qui les rappelle et les construit dans le savoir présent de l’historien. » (Devant le temps, Minuit, 2000, p. 103) Ce qui permet au philosophe français d’envisager un nouveau paradigme historique pour une histoire de l’art repensée à partir de l’anachronisme et d’une stratégie générale du « rebrousse-poil », c’est l’émergence de l’image dialectique comme forme du négatif donnant « justement le moteur dialectique de la création comme connaissance et de la connaissance comme création. » (Georges Didi Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Editions de Minuit, 1992, page 135). Le mouvement de cette forme dynamique de la mémoire ne cherche pas à posséder mais à mettre en rapport, elle cherche à créer un rapport dialectique. Son authenticité réside dans son sens critique. C’est en effet dans sa capacité de faire vaciller les certitudes et de renverser les continuités qu’elle ouvre son écart qui ne se ressaisit que dans le retard qu’elle produit.
L’image qui se constitue dans ce nouveau rapport dialectique repose alors sur le double enjeu de l’arrêt et du montage. En déréglant les visibilités communes, l’image dialectique n’est pas une image qui s’offre ou se donne. Elle s’inscrit dans un travail de trace et de bifurcation. En ce sens, l’arrêt dialectique dont parle Walter Benjamin n’est pas celui d’une dialectique immobile, d’une dialectique qui se serait arrêtée. Ce qui s’arrête, c’est un modèle d’inertie. Ce qui émerge, c’est le rythme du négatif, c’est la possibilité d’une autre forme de visibilité à partir d’un moment fragile et fulgurant. C’est ce qui constitue l’éveil benjaminien comme moment de ressaisie de la complexité de la pensée et de son enjeu de connaissance. Cette reconstruction dans l’écart par le retard qu’elle induit est celle d’une conscience aiguë de la perte (le prix de la modernité) et du pari benjaminien face à la fin de l’aura et la possibilité artistique dans l’époque de la reproduction technique. Parlant de l’image comme surgissant de cette pliure dialectique, Georges Didi Huberman avance qu’elle « n’est pas l’imitation des choses, mais l’intervalle rendu visible, la ligne de fracture entre les choses » (Georges Didi Huberman, Georges, Devant le temps, page 114).
[11] Walter Benjamin, Charles Baudelaire, traduction Jean Lacoste, Paris, Petite bibliothèque Payot, 1990, p. 81.
[12] L’image dialectique trouve son authenticité critique dans une résistance oblique. La fracture que le moment d’arrêt implique vient se mesure dans le montage. En effet, le montage brise l’action fluidifiante du continu par un remontage, lequel permet d’échapper au caractère fixe et fixé de l’événement. Il ouvre un événement qui ne se réduit plus à l’immédiateté. Le montage est le cœur du projet benjaminien.
« La méthode de ce travail : le montage littéraire. Je n’ai rien à dire. Seulement à montrer. Je ne vais rien dérober de précieux ni m’approprier des formules spirituelles. Mais les guenilles, le rebut : je ne veux pas en faire l’inventaire, mais leur permettre d’obtenir justice de la seule façon possible : en les utilisant. » Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, Op. Cit., Fragment [N 1a, 8], page 476.
Le montage permet de prendre acte des nouvelles formes artistiques dans le paysage de la reproductibilité technique. Il engage un nouveau dialogue dialectique, opère une médiation et ouvre à la complexité en saisissant le travail de l’ambiguïté de l’image. Le montage démonte le chapelet de l’histoire.
« L’historicisme se contente d’établir un lien causal entre divers moments de l’histoire. Mais aucune réalité de fait ne devient, par sa simple qualité de cause, un fait historique. Elle devient telle, à titre posthume, sous l’action d’événements qui peuvent être séparés d’elle par des millénaires. L’historien qui part de là cesse d’égrener la suite des événements comme un chapelet. Il saisit la constellation que sa propre époque forme avec telle époque antérieure. » Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, traduit de l’allemand par Maurice de Gandillac, revu par Pierre Rusch, Op. Cit., pages 442-443.
L’événement qui se saisit dans le remontage (celui qui brise l’effectivité du contenu) constitue une distance en déinscrivant l’œuvre de la reproduction et de l’aliénation (harmonie de la forme, immédiateté du flux).
[13] Walter Benjamin, Sens unique-Enfance berlinoise, traduction Jean Lacoste, Paris, 10/18, 2000, p. 13.
[14] Walter Benjamin et Gershom Scholem, Théologie et utopie. Correspondance 1933-1940, traduit de l’allemand par Didier Renault et Pierre Rusch, Paris, Les Éditions de l’éclat, 2010, p. 44.
[15] Walter Benjamin et Gretel Adorno, Correspondance (1930-1940), traduit de l’allemand par Christophe David, Paris, Le Promeneur-Gallimard, 2007, p. 381.
[16] Walter Benjamin, Dernières lettres, traduction de Jacques-Olivier Bégot, Paris, Rivages, 2014, p.162-163.
[17] Arthur Koestler, La Lie de la terre, traduit de l’anglais par Jeanne Terracini, Paris, Calmann-Lévy, 2013, p. 298. Arthur Koestler se suicide avec sa femme en 1983. Hans Sahl, dans ses notes autobiographiques, rapporte un fragment des derniers mots de l’écrivain : « Je voudrais informer mes amis que je quitte en paix leur compagnie avec l’espoir d’une survie impersonnelle après la mort, au-delà du temps, de l’espace, de la matière, au delà de l’entendement humain. » Hans Sahl, Survivre est un métier, Paris, Les Belles Lettres, 2016.
[18] « Certes, la critique se fait au présent : elle diagnostique le temps qui est le sien, elle aime et réserve ses coups au présent qui lui est fait. Mais, du même coup, elle n’est pas de son temps : à la fois elle accuse son retard et pointe son avance possible. C’est en ne coïncidant jamais avec son temps, en refusant de céder à sa pente naturelle, en bataillant contre lui, bref en lui résistant que simultanément elle prend le risque d’être archaïque et qu’elle saisit la chance d’être inventive. », Françoise Proust, De la résistance, Les éditions du cerf, 1997, p. 85.
[19] (« Überwindung des Kapitalismus durch Wanderung », Fragment, 113, (1921). La phrase n’apparaît pas dans la traduction française.
[20] Jacques DERRIDA, Parages, Galilée, 1985, p. 30.
[21] Franz HESSEL, Promenades dans Berlin, traduit de l’allemand par Jean-Michel Beloeil, Presses universitaires de Grenoble, 1989, p. 31.
[22] Hannah Arendt, Walter Benjamin, 1892-1940, traduit de l’anglais par Agnès Oppenheimer-Faure et Patrick Lévy, Editions Allia, 2007, p. 45.
[23] « Schewerer ist es, das Gedächnis des Namenlosen zu ehren als der Beruhmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht. » Walter Benjamin (citation inscrite au bas de l’installation de Dany Karavan à Port-Bou, en hommage à Walter Benjamin).
« C’est bien plus difficile d’honorer la mémoire des anonymes que celle des personnes célèbres. La construction historique est consacrée à la mémoire de ceux qui n’ont pas de nom. »
[24] Il est frappant de constater que le destin de l’Europe se dessine au travers de la famille de Benjamin :
Walter fuit l’Allemagne nazie dès 1933. Walter Benjamin En tentant de fuir la France envahie et vichyste en 1940, il se suicide à Port-Bou.
Il a un fils, Stefan, très fragile qui est soigné à Vienne en 1938. Il a 19 ans et réussit à quitter la capitale autrichienne avant l’arrivée des nazis. L’Anschluss volontaire et joyeux, l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie a lieu le 12 mars 1938.
Stefan et sa mère Dora devront fuir en 1939 l’Italie mussolinienne qui met en place de nouvelles lois raciales. Ils iront à Lourdes, où Stefan semble trouver un équilibre. Dora tente de persuader Benjamin les y rejoindre. Dora et son fils réussiront à rallier Londres. Elle y mourra en 1964. Stefan décédera également dans capitale anglaise en 1972.
Georg Benjamin, le frère de Walter, lui, n’a pas traversé les frontières : il est médecin et conseiller municipal communiste à Berlin. Il est arrêté une première fois le 12 avril 1933, puis une seconde fois le 14 mai 1936 par les nazis. Accusé de conspiration, il est condamné à six ans de prison. Il est assassiné en 1942 à Mauthausen.
