Accueil > Articles > 2011 > Au bout de l’image, la relève des morts
Au bout de l’image, la relève des morts
vendredi 3 décembre 2021, par
C’était en 2009, invité par le séminaire interarts de Paris à participer aux conférences de l’année autour du thème « L’extrême », j’avais commencé par réfléchir sur la question de la représentation du corps du mort. La question entre dans mes réflexions sur les fantômes et sur la question du dernier portrait (la question du corps des morts-vivants dans le cinéma contemporain apparaissant de manière marginale).
Invité en septembre pour janvier, il fallait donc travailler assez rapidement pour développer un peu une proposition de travail, et faire quelques recherches.
Cependant, la sortie en novembre 2009 du film d’Alain Cavalier Irène a parfaitement bouleversé mes projets. Il fallait parler de ce film, plus exactement, il me fallait parler de ce film. Je retournai voir le film deux fois, prendre quelques notes et prolonger la réflexion, et couper mes réflexions pour d’autres qui s’imposaient. Le séminaire a eu lieu et a donné lieu à une publication chez Klincksieck. Je laisse l’article dans son état d’écriture et de réflexion de 2009.
Alain Cavalier est un cinéaste pour qui j’ai une admiration sans borne. Totalement conquis par La Rencontre à sa sortie, j’étais encore en 1996, sous le coup de Libera me (1993), et de toutes les pistes que son cinéma ouvrait alors. Irène poursuit, prolonge et me touche profondément.
Depuis, quelques échanges se sont tissés avec le filmeur, et notamment un bref entretien autour de Pater pour la revue NRP (parution mai 2013).
Le texte est mis en ligne sans modification.
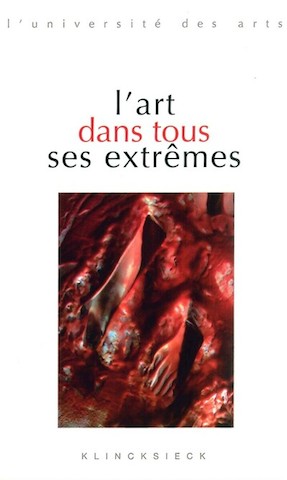
L’œuvre de l’art est une incessante confrontation à la mort. Incessante car toujours non coïncidente, la mort prend en défaut quand elle ne prend pas à défaut. Mais la banalité de ce sans précédent de la mort est toujours une confrontation déceptive. Entre déjà-plus et pas-encore, l’enjeu de l’art est constamment rapporté à cet écart radical. L’art, pour reprendre une expression de Michel Deguy, fait sépulture, porte sans fin l’inaccomplissement d’une dialectique disparu/disparition par la tension du disparaissant.
La littérature invente sans cesse depuis Homère ces tombeaux profanes, comme autant de profanation du temps. De la catabase d’Ulysse ou d’Orphée, au bal proustien, en passant par la poésie du tombeau ou l’écriture d’un Michon, la littérature affronte, dans la disjonction, les veilles du deuil. L’image n’est pas en reste. Son pouvoir de semblance ouvre d’autres portes et donne à la vue la possibilité de creuser d’autres écarts. Et d’envisager ici la photographie et le cinéma comme espaces des morts, territoires dans lesquels s’articule une dialectique de l’apparition du disparu dans la chair même du disparaîsant : l’image, l’idée d’une image comme confrontation au retour et à la spectralité, une question générale de la revenance. C’est alors un espace privilégié pour une pensée de la mort et du mort.
Pistes pour une lecture hantologique de l’image
Il faut commencer par une lecture hétérodoxe de La chambre claire (1980) de Roland Barthes qui dirait en substance que les discussions théoriques de Barthes autour du punctum et du studium sont des alibis, des contre-feux qui cachent l’enjeu essentiel de la photographie absente (et de préciser immédiatement : absente pour le lecteur), une écriture de la disparition de sa mère dans le livre et par le livre, une mise en écriture de l’absence. Cette piste est largement confirmée par la publication au Seuil en 2009 du Journal de deuil de Roland Barthes, ensemble de notes et fragments écrits au moment de la mort de sa mère. Par ailleurs, le Roland Barthes par Roland Barthes (1975) travaillait et creusait déjà cette place du photographique dans sa pensée atopique du biographique. La question de l’image photographique rejoint ici une question du fantômal et une analyse anthropologique de la représentation du mort, de la mise en image du mort, Barthes opérant dans La Chambre claire, une mise en absence de l’image de la mère comme iconicité possible de la mort.
… Et poursuivre par un bref rappel des questions soulevées par Jacques Derrida au sujet de l’image cinématographique. Derrida développe une pensée hanthologique [1] du cinéma comme articulation technique et esthétique d’une pensée de la présence et de l’absence. Je partirai simplement d’une anecdote rapportée par Derrida lui-même au sujet de sa participation au film de Mc Mullen GhostDance (1982). Il ne s’agit pas de revenir sur la phrase célèbre énoncée par Derrida dans ce film : « psychanalyse plus cinéma égale… science de fantômes ». Non il s’agit de revenir sur la mort à l’œuvre dans l’image même produite par ce film. En effet, une des séquences du film est construite autour du dialogue serré yeux dans les yeux entre Pascale Ogier et Jacques Derrida, ce dernier devant demander à la comédienne au cours de l’échange : « Et vous alors, est-ce que vous y croyez aux fantômes ? ».
Derrida raconte : « Et en la répétant de nouveau au moins trente fois, à la demande du cinéaste, elle dit cette petite phrase : « Oui, maintenant, oui. » Déjà dans la prise de vues, donc, elle l’a répétée au moins trente fois. Déjà ce fut un peu étrange, spectral, décalé, hors de soi, cela arrivait plusieurs fois en une fois. Mais imaginez quelle a pu être mon expérience quand, deux ou trois ans après, alors que Pascale Ogier, dans l’intervalle, était morte, j’ai revu le film aux Etats-Unis à la demande d’étudiants qui voulaient en parler avec moi. J’ai vu tout à coup arriver sur l’écran le visage de Pascale, que je savais être le visage d’une morte. Elle répondait à ma question : « Croyez-vous aux fantômes ? » En me regardant quasiment dans les yeux, elle me disait encore, sur grand écran : « Oui, maintenant, oui. » [2]
Outre cette expérience intime de la présence d’une absence, ce que Derrida met en lumière, c’est l’idée que le cinéma est un cimetière vivant. L’image imprimée, le défilement de la pellicule peut déjà induire une dialectique de la l’apparition/disparition, mais c’est plus généralement l’ensemble du cinématographique qui est tombeau ouvert sur d’infinis cadavres.
Cette réflexion sur l’extrême de l’image comme affrontement de la mort et du mort est le prolongement direct d’une réflexion ouverte lors d’un précédent séminaire qui n’a pu se tenir. Il s’agissait de creuser la question du regard d’Eurydice. Intitulé « la nuit d’Eurydice » [3], il s’agissait d’interroger un regard faisant apparaître la disparue en tant que telle, de regarder la disparition et de faire face à une image creusée par la mort : regarder la disparition, regarder en face ce qui, de la mort, se dérobe, dans la mort.
Postulant l’idée d’image photographique ou cinématographique comme pays des morts, la réflexion envisagera la place du mourir, et celle du cadavre dans ces images.
Quelques prémices archéologiques de l’image
Il y a d’abord la redécouverte de la photographie d’Hippolyte Bayard, Autoportrait en suicidé par noyade datant du 18 octobre 1840, en ouverture de l’exposition Controverse. Bayard, photographe et inventeur en photographie s’est battu contre le pouvoir qui accordait toutes ses faveurs aux inventions de Daguerre. En vain. Il met donc en scène en 1840 une photographie de sa propre mort, geste politique de défiance, et geste esthétique de fictionnalisation photographique de la plus haute importance qui s’accompagne au dos de la photographie du texte suivant, écrit que la main même de Bayard (le mort, donc) :
« Le cadavre de Monsieur est celui de M. Bayard, inventeur du procédé dont vous venez de voir, ou dont vous allez voir les merveilleux résultats. A ma connaissance, il y a à peu près trois ans que cet ingénieux et infatigable chercheur s’occupe de perfectionner son invention.
L’Académie, le Roi et tous ceux qui ont vu ses dessins, que lui trouvait imparfaits, les ont admirés comme vous les admirez en ce moment. Cela lui a fait beaucoup d’honneur et ne lui a pas valu un liard. Le Gouvernement, qui avait beaucoup trop donné à M. Daguerre, a dit ne pouvoir rien faire pour M. Bayard et le malheureux s’est noyé. Oh ! Instabilité des choses humaines ! Les artistes, les savants, les journaux se sont occupés de lui et aujourd’hui qu’il y a plusieurs jours qu’il est exposé à la morgue, personne ne l’a encore reconnu ni réclamé. Messieurs et Dames, passons à d’autres, de crainte que votre odorat ne soit affecté car la figure du Monsieur commence à pourrir, comme vous pouvez le remarquer. » [4]
Il y a ensuite la confirmation du premier cas de photographie daguerréotype post-mortem attestée dès le 14 octobre 1839 par le Docteur Alfred Donné : Comptes rendus de l’Académie des Sciences : lettre signée par le docteur ALFRED DONNE : « « J’ai l’honneur de vous adresser de nouvelles images Daguerriennes gravées par le procédé dont j’ai soumis les premiers essais à l’Académie. » L’auteur dresse la liste des œuvres en question et ajouter : « J’ai obtenu déjà un très beau résultat en prenant l’image d’une personne morte. » Malheureusement aucune trace de ce daguerréotype n’a été retrouvée. » [5]
En prolongement de cette question médicale, il y a l’entrée fracassante du film chirurgical dans l’histoire du cinéma avec le célèbre et controversé Eugène-Louis DOYEN : le 29 juillet 1898 a lieu la première projection officielle de ses films lors d’une réunion de l’Association médicale britannique à Edimbourg. On a pu y voir une hystérectomie abdominale et une craniectomie. Il a également renforcé sa célébrité médiatique et cinématographique en filmant le 9 février 1902 la séparation de deux sœurs xyphopages (reliées par l’extrémité inférieure du sternum), les deux siamoises Doodica et Radica appartenant également à la tournée du cirque Barnum (la célèbre « galerie des monstres »). Mais ici pas de cadavre, seulement un rapport au corps et à l’image du corps singulière et violente car ces opérations filmées articulent au geste médical et à la volonté pédagogique une mise en scène particulièrement de sa personne et de ses expériences particulièrement efficace.
La question du cadavre et de la vision du cadavre (l’autopsie, c’est littéralement voir par soi-même) se retrouve dans d’autres travaux d’Eugène-Louis Doyen, et notamment son Atlas d’anatomie topographique publié en 1910. Véritable « ancêtre de l’imagerie IRM, l’atlas en sept parties regroupe 279 photographies de corps humains soigneusement tronçonnés à l’aide d’une scie à ruban, avant d’être plongé dans différents bains (…) les corps une fois tranchés étaient tout aussi spectaculaires : par différents procédés chimiques les couleurs de ces tranches de 3 ou 4 centimètres d’épaisseur étaient minutieusement maintenues très vives, puis méthodiquement photographiées dans un laboratoire équipé d’un matériel de prise de vue haut de gamme réalisant des autochromes grand format. » [6]. Ici se dessine le débordement des frontières entre une fonction documentaire et une mise en scène spectaculaire du cadavre, articulant déjà les deux niveaux de l’image [7].
On constate donc que, durant l’année 1839-1840, sont posées et se développent deux formes, deux possibilités cinématographiques, l’une affrontant le réel, l’autre mettant en scène une fiction. Et de faire alors un rapprochement avec une réflexion de André S. Labarthe évoquant les différentes versions de la célèbre vue des frères Lumière intitulée Sortie d’usine. Labarthe propose de lire ces variations comme une immédiate croisée des chemins : la vue primitive ouvrirait la piste documentaire du cinéma ; la deuxième, puis la troisième vue inscrirait déjà une mise en scène, une fictionnalisation et lancerait le cinéma vers la fiction par l’affirmation d’une mise en scène, d’une parfaite maîtrise du temps et de l’espace au-delà de l’angle de prise de vue confirmé par les différentes versions. André S. Labarthe conclut alors que « dès le premier film le cinéma a eu besoin de la fiction » [8]
Toute proportion gardée quant aux rapprochements qui n’a qu’une valeur méthodologique, il est troublant de constater que le cadavre est à l’œuvre dans l’apparition des différentes formes et technologies de l’image photographique. Par ailleurs, la catégorie générale de la photographie post-mortem prolonge et approfondit une question anthropologique décisive liée à la représentation du mort, au rite funéraire, et au thème du deuil… entre désymbolisation scientifique et resymbolisation par l’invention de nouvelles pratiques : le « dernier portrait » s’articule alors aux pratiques funéraires classiques allant du gisant au masque funéraire en passant par le dessin, le tableau du mort sur son lit d’agonie, ou encore les masques de cire l’Antiquité [9].
Une première perspective
La place et la représentation du mort dans la société contemporaine sont devenues problématiques. Le culturel [10] contemporain a différentes stratégies de déni du cadavre et de la mort. Quelques pistes seulement soulevées ici permettent de prolonger l’interrogation à commencer par la cosmétique de l’éternelle jeunesse qui n’est pas seulement une question marketing mais bien un enjeu contemporain de société ; les nouveaux rapports à la morts induits par les images occidentales de guerres (la doxa américaine des deux guerres du Golfe ou du 11 septembre : pas d’image de cadavre et une rhétorique de la guerre chirurgicale comme autant de leçon du traitement médiatique de la guerre du Vietnam) ; a contrario, la neutralisation de la mort par sa banalisation (dans les journaux télévisés les cadavres sont coincés entre la hausse des impôts et les nouvelles des célébrités du moment) ; une sur-présence et/ou sur-visibilité du cadavre et des figures du mal au cinéma ou dans les séries télé (c’est une autre forme de neutralisation entre nouvelle doxa pulsionnelle de l’image et violence neutralisée par un devenir festif de la mort : la mise en scène ludique de la violence) ; les problèmes d’éthique publique liés à l’affaiblissement des frontières entre vivants et morts. On peut penser par exemple au cas de cette femme qui voulait utiliser le sperme congelé de son mari décédé pour concevoir un enfant. Question posée à la société : un mort peut-il procréer ? La société peut-elle cautionner, voire encourager un déni de mort ? Tout cela au-delà de la démarche individuelle de cette femme que l’on peut évidemment comprendre. Autre cas, autre problème similaire : le mariage post-mortem). En somme, dans le monde occidental contemporain, la mort n’est jamais à sa place, n’a d’ailleurs quasiment plus de bonne place (sans parler des convoitises immobilières sur les cimetières). L’anthropologie nous a appris que le rapport à la mort passe par un rapport au mort, et que la ritualisation de ce rapport, outre une question d’hygiène évidente, est un passage déterminant à la culture. Dès lors, de se demander si le déni qui traverse nos sociétés contemporaines est (ou non) le symptôme d’une inversion de trajet.
Ma première proposition est d’articuler deux films et de placer une bascule symbolique de la relation à la mort à la fin des années 1960, moment d’acmé d’une conscience basculant dans le crépusculaire, sans doute revenue de toutes les expériences.
D’une part le documentaire Gimme Shelter (1970) et d’autre part la fiction La Nuit des morts-vivants (1968) de Romero… ces deux films prolongeant et bouclant en quelque sorte le film d’Abraham Zapruder, film amateur ayant saisi le 22 novembre 1963 l’assassinat brutal et violent de JF Kennedy à Dallas [11].
Gimme Shelter, film documentaire de Charlotte Zwerin et Albert Mayles, montre la tournée 1969 des Rolling Stones, et notamment le célèbre concert Altamont. Les Stones mettent sur pied un « peace concert » au cours duquel un spectateur noir, Meredith Hunther, est tué par un membre des Hells Angels, chargés du service d’ordre. Les cinéastes filmèrent cette mort quasiment sans le savoir. Mike Jagger, sur scène, ne voit rien du coup de couteau fatal. Il chante. Il est loin. La caméra enregistre. Mais le film montre ensuite le chanteur visionnant ces images, regardant – jusque dans l’arrêt sur image – la mort de ce spectateur. Effet de saisissement et de silence : Jagger incarne littéralement le regard théorique du personnage de Blow up et rejoint la réflexion menée précédemment sur la nuit d’Eurydice. Ce voir la mort, voir le mort rabat les espoirs des années 1960, et ferme les soubresauts utopiques de la décennie. Après cela le groupe entre définitivement dans la mécanique de l’industrie culturelle.
Le second film envisagé est La nuit des morts vivants de Georges Romero (et l’ensemble des films de morts vivants de son auteur constituant un ensemble très articulé). A cette occasion de rappeler bien sûr la métaphore politique du mort vivant chez Romero [12] en la distinguant nettement des productions contemporaines du genre qui ne renvoient à aucune pensée politique ni à aucune mise en scène de l’extrême mais proposent seulement un disposition d’encadrement et d’accompagnement du pulsionnel ; ou une neutralisation de l’horreur possible par la dérision, la dose de parodie, de second degré interdisant ici toute forme d’extrême. Les films de Romero sont traversés, sur un mode crépusculaire, par une critique du racisme, de la société de consommation, par une dénonciation du lobby militaro-industriel dominant les pouvoir occidentaux et une critique radicale du capitalisme contemporain ainsi que l’effacement du sens de sens par la démultiplication pétrifiante des images et leur manipulation.
Mais la question politique des films de Romero ne doit pas occulter un premier plan d’analyse : la présence des corps, la présence de ces corps particuliers, ces cadavres articulés qui sont une pure présence sauvage et instinctive. C’est la forme d’une rupture radicale avec toute socialisation possible et finalement toute forme de société. Ce corps-cadavre articulé, fonctionnelle, est débarrassé de toute humanité. Il ne répond qu’à une logique de consommation. Ce qui est particulièrement pertinent dans La Nuit des morts vivants comme dans les autres films de zombie de Romero, c’est l’absence d’explication, l’effacement de tout régime de causalité pour poser une donnée matérielle et matérialiste du corps-cadavre comme miroir-monstre de la société, et ce en se débarrassant de toute métaphysique, et en construisant une figure anthropologique de l’effondrement de toute culture possible.
Seulement une rencontre cinématographique…
Mais cette approche, articulant un documentaire à une fiction, pour réfléchir sur une bascule du rapport au mort et à la mort [13], a été supplantée par une autre : la découverte du dernier film d’Alain Cavalier, Irène, sorti sur les écrans français en novembre 2009 au moment de la rédaction de la conférence dont est issu ce texte. Cavalier s’est alors imposé et a remplacé l’argument par la nécessité de la réflexion. Avec le cinéaste français, on entre dans un tout autre régime cinématographique, véritable subversion des statuts de l’industrie culturelle par un filmage intime, débarrassé des habitudes et des formats du cinéma. Ce film est l’occasion d’une double articulation sur la mort et le cadavre.
Ce film de Cavalier s’articule en effet sur deux morts, sur deux cadavres et sur la confrontation cinématographique de deux positions : la place du mort et la place de la mémoire, la question du cadavre et celle de l’empreinte du passé. Et, en dernier ressort, le surgissement d’un fantôme cinématographique par le filmage d’un cadavre.
Les morts appellent et rappellent les morts. La mort de la mère du cinéaste fait revenir une autre disparue, Irène, femme du cinéaste décédée après un accident de voiture. Le film est le rappel de cette mémoire, mémoire ravivée par cette mort maternelle. Le cœur du film est une enquête sur la possibilité cinématographique d’une mémoire des morts. Son cadre est maternel. C’est elle qui ouvre et clôt le film, liant dans cette clôture sa mémoire à celle d’Irène.
Deux corps, deux images du cadavre et différents rapports à l’image qui sont également une trace du rapport de l’image avec le cadavre (inscription quasi anthropologique).
Le premier corps, c’est celui de la mère. C’est un dernier portrait. Le cinéaste Alain Cavalier renoue cinématographiquement avec ce geste, faire le dernier portrait du défunt, garder trace, non pas du vivant mais de son absence, de son absentement définitif. La rareté du geste mérite qu’on s’y arrête quelques instants. Il ne s’agit pas ici d’un simple geste intime et personnel comme il en existe toujours – on pratique encore le masque mortuaire, la photographie mortuaire, peut-être même des prises de vue vidéo, cependant les données et les analyses manquent. Le geste de Cavalier est différent en ceci qu’il s’inscrit dans une œuvre artistique, dans un geste esthétique plus général. Dans Irène, ce geste n’est pas radical, violent, péremptoire, manipulatoire ou provocateur. Cavalier agit avec une infini douceur et délicatesse, éloignant de ses plans toute morbidité.
C’est au tout début du film. Pas le premier plan parce que trop symboliquement chargé, trop immédiatement et lourdement significatif. C’est au deuxième et troisième plan du film qu’apparaissent ces images. Les deux plans saisissent. Pas immédiatement. Il faut deux courts plans pour comprendre que ce corps étendu est celui d’une mère morte, que le lit est mortuaire et l’image sépulcrale. L’image acquiert une immense intensité par sa présence et sa pudeur. Deux plans un peu tremblants, en légère plongée (plan moyen (ou américain) latéral droit pour le deuxième et de face pour le troisième) ne cherchant à révéler aucun mystère, ne posent aucune métaphysique. Une image sans trivialité ni morbidité, ne chercent à saisir aucun événement mais témoignent d’un événement : le corps de la morte, ce qu’il reste après le mourir. Le choix de l’exposition funéraire (la morte allongée et habillée) inscrit le geste de Cavalier dans la tradition du « dernier portrait », rapprochant donc ces images cinématographiques des moulages et masques de cire antique, des masques mortuaires du Moyen Age à aujourd’hui, des dessins, des peintures, tableaux et photographies élaborant les dernières images d’un défunt. Ce dernier portrait qui cherche une bonne distance cinématographique pour n’être ni magnification d’un insaisissable, ni forme de spectacle, ni sa mise en scène (ce par quoi le Nick’s movie de Wim Wenders est parasité : la mise en scène agissant dans ce cas comme un évitement, un contournement du sujet véritable de ce film : la mort au travail dans le corps de Nicholas Ray).
Cavalier, depuis Ce répondeur ne prend pas de messages (1978) puis La Rencontre (1996), a coupé les fils du cinéma classique, d’un cinéma répondant à une organisation industrielle, pour une forme libre et libérée, trouvant avec la caméra DV l’outil essentiel pour répondre aux nécessité de l’élaboration de son œuvre (comme la nagra et la caméra 16 avaient en leur temps impulsés ou accompagnés les choix esthétiques de la Nouvelle Vague). Avec ses caméras numériques, Cavalier affronte depuis en fragment son intimité : la dépression, la rencontre amoureuse, la maladie, et la mort.
Filmer deux plans du cadavre de sa mère, c’est affronter la solitude du regard et une intimité qui n’en est pas une, qui n’en est plus une. Ce n’est pas l’événement de la mort mais la place de la morte qu’il filme. Voir et filmer le cadavre n’est pas ici un geste d’outrage, une quelconque transgression. C’est un geste artistique inscrit dans une anthropologie, une histoire de l’art, celle du « dernier portrait », et dans une esthétique cinématographique spécifique, celle de Cavalier. La mort et la morte sont affrontées par l’image, par cette mise en distance qui n’est pas séparation. Ces deux plans de Cavalier sont également le témoignage d’une confrontation assumée et vécue : celle du cadavre vu. Et c’est par ce voir-le-cadavre que la mémoire fait retour sur une autre morte, Irène. C’est parce qu’il y a l’image de cette morte que l’image de la morte sans cadavre peut cinématographiquement prendre corps, et entrer dans une définition du fantomal.
Irène est un corps absent. Un corps rendu invisible par la mort, par la brutalité d’un accident qui laissera une empreinte de douleur inapaisable. Cet apaisement impossible conduit Cavalier d’une morte l’autre. Une des explications possible de ce tombeau (ouvert) constitué par ce film est peut-être à comprendre dans la confidence faite à la fin du film : il a laissé son frère aller reconnaître le corps d’Irène. Il n’est pas allé voir le cadavre de sa femme, ajoutant « Si j’étais allé voir son visage mort, peut-être que je n’aurai pas fait ce film. ».
Irène est le film d’un corps absent, d’un cadavre qui n’a pas lieu, ou plus exactement d’une absente radicale qui n’a lieu que dans le film. Quel corps peut-il rester face à un tel absentement ? Un corps d’image. Le film d’Alain Cavalier est très littéralement une catabase cinématographique à la recherche de ce corps de disparition. Irène meurt le 16 janvier 1972, quelques jours avant que Cavalier ne doive commencer avec elle le tournage d’un film sur elle. 36 ans plus tard, le cinéaste invente une image d’Irène, au sens où « inventer » c’est à la fois construire et trouver (l’inventeur d’un trésor).
Il construit un tombeau et trouve des images.
Cavalier invente les signes de l’absence sans jamais chercher à remplir le vide.
La visite de la maison d’amis, celle du dernier jour, celle du jour de l’accident est à ce titre magnifique et terrible : il se rend dans cette maison, 35 ans après le drame, filme tous les détails des lieux, scrute chaque détail, rappelle toutes les anecdotes qui reviennent. Il filme le souvenir de l’annonce : « j’étais assis là au bout du canapé » dit-il, c’est la même pièce, le même canapé, le même tapis. Il raconte et filme ce présent vide de tout passé… il filme le canapé et après un léger panoramique termine son plan sur un tapis blanc en disant « Voilà, c’est tout ». Cette image est alors l’exact contrepoint de Ce répondeur ne prend pas de messages (film de la noire folie où plane l’ombre d’Irène jamais nommée… seulement entendue). Ce blanc dans Irène n’est pas encore le vide. Le vide survient lorsqu’il apprend que cette même maison est vendue et donc vidée. Le lieu dépositaire de cette mémoire s’absente de lui-même définitivement, s’évide littéralement : « La maison où j’ai appris la mort d’Irène est vendue (…) Je n’arrive plus à voir Irène se déplaçant » entend-on sur des plans explorant un vide désormais radical : plus de porte-savon, plus de meubles, de lits, plus de téléphone, plus de canapé, ni de tapis. Seules les images photographiques de la maison permettront désormais de dire la disparition de la disparue.
Dès lors, Cavalier trouve des images, prend les images passées, celle d’Irène, celle de la maison, celle de la voiture accidentée. Les photographies permettent alors d’affronter le récit, de dire de nouveau le moment de la mort d’Irène en l’absence de toute image de sa mort, d’elle morte, ou plus exactement d’elle en morte.
Cavalier filme donc les images photographiques d’Irène. Le cinéma de Cavalier depuis 1978 se constitue sur une tension : la possibilité de filmer le visage : avec le répondeur le visage était obstrué, caché par les bandes médicales ne laissant paraître que les yeux ; avec Libera me (1996) les visages m’étaient jamais filmés ; dans La Rencontre (1996), le visage de Françoise est invisible, à peine un reflet fugace sur une glace, et surtout un photogramme de ce visage, c’est-à-dire ici une réelle question cinématographique : une présence dans la matière du film in absentia d’une perception possible dans le défilement cinématographique. En somme, une véritable image de l’intimité. A contrario, Thérèse (1986), 24 portraits (1987-1990), René (2002) ou le Filmeur (2005) travaillent dialectiquement les possibilités d’inscrire le visage dans un plan.
Ce qui est saisissant dans Irène, c’est que Cavalier met en tension cette possibilité en scrutant une image d’Irène sans montrer son visage, en restant longtemps à cette lisière avant de cadrer sur son visage encore caché par ses cheveux, puis de montrer d’autres photographies du visage d’Irène… comme s’il se libérait d’un interdit, d’une impasse, d’une impossibilité. Il ne lui était pas possible de faire incarner Irène par une autre (séquence avec la comédienne envisagée au sens littéral du terme, ou la séquence autour Sophie Marceau avec qui il instaure un dialogue imaginaire). Il peut seulement tenter (enfin) des images c’est-à-dire aller dans le royaume des ombres pour dialoguer avec elle : « je préfère descendre vers l’ombre seul » dit-il ; puis ajoute, plus tard, s’adressant à elle : « Je suis venu te demander pardon ».
Cette sépulture cinématographique d’une mémoire déchirée n’est rendue possible que par la mort de la mère et l’image quasi inaugurale, et ici augurale, de dernier portrait. Une fois de plus, c’est la structure du film qui l’indique. En effet, le film s’achève par un plan sur la table de chevet de sa mère sur laquelle se trouve une photographie d’Irène dans un cadre rond. Et Cavalier d’ajouter : Après la mort d’Irène, ma mère a toujours gardé une photographie d’elle à son chevet. J’ai longtemps cru que c’était pour me faire plaisir. Aujourd’hui je pense différemment. »
Irène, film d’Alain Cavalier fait ici doublement sépulture. Il affronte cinématographiquement l’épreuve de la mort de sa mère par un dernier portrait et construit un tombeau qui accueille le fantôme de celle qui mourut un après-midi de janvier au bord de la forêt de Rambouillet. Irène, c’est, comme le dit Roland Barthes dans son Journal de deuil, « habiter mon chagrin » [14].
[1] Voir Jacques Derrida, Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1993 et Jacques Derrida, « Le cinéma et ses fantômes », entretien avec Antoine de Baeque et Thierry Jousse, Les Cahiers du cinéma, numéro 556, avril 2001, p. 74-85.
[2] Jacques Derrida et Bernard Stiegler, Echographie-De la télévision, Paris, Galilée-INA, 1996, p. 135.
[3] On retrouve les éléments de cette réflexion ici : http://sebastienrongier.net/spip.php?rubrique34
[4] Texte reproduit dans André Rouillé, La photographie en France. Textes et controverses : une Anthologie (1816-1871), Paris, Macula, 1989 (coll Histoire et théorie de la photographie, 549 p.), p. 64.
[5] Joëlle BOLLOCH, « Photographies après décès : pratiques, usages et fonctions », in Le dernier portrait, sous la direction de Emmanuelle Héran, Paris, Musée d’Orsay-Editions de la Réunion des musées nationaux, 2002, pages 112-113.
[6] Stéphanie de Loppinot, « L’expérience intérieure. Le cinéma chirurgical du docteur Doyen » Cinéma, numéro 013, printemps 2007, pages 101-102
[7] En prolongements problématiques et contemporains à cette question, on pourrait se pencher sur The Act of Seeing With One’s Own Eyes film de 1971 de Stan Brakhage ou les installations-spectacles des plastinations de Gunther von Hagens.
[8] André S. Labarthe, « Des images nous regardent » Entretien Jean-Louis Comolli et André S. Labarthe, dans Images documentaires, n° 31, 2ème trimestre 1998, p. 20.
[9] Voir le catalogue de l’exposition Le dernier portrait, sous la direction de Emmanuelle Héran, Paris, Musée d’Orsay-Editions de la Réunion de musées nationaux, 2002.
[10] J’empreinte conjointement le terme de culturel à Theodor W. Adorno, à Marc Jimenez, à Michel Deguy, ainsi qu’à l’analyse de Martin Rueff sur la question de la sur-visibilité. Voir Theodor W. Adorno, Dialectique négative, traduit de l’allemand par le groupe de traduction du Collège de philosophie, Paris, Payot, 2001 ; Théorie esthétique, traduit de l’allemand par Marc Jimenez, Paris, Klincksieck, 2004 ; Modèles critiques, traduit de l’allemand par Marc Jimenez et Eliane Kaufholz, Paris, Payot, 1984 ; Michel Deguy, La Raison poétique, Paris, Galilée, 2000 ; Marc Jimenez, La critique : Crise de l’art ou consensus culturel ?, Paris, Klincksieck, 1995 ; Martin Rueff, Différence et Identité, Paris, Hermann, 2009.
[11] Voir à ce sujet l’éclairant livre de Jean-Baptiste Thoret, 26 secondes, l’Amérique éclaboussée, Pertuis : Rouge profond, 2003.
[12] Voir à ce sujet Politique des zombies. L’Amérique selon George A. Romero, coordonné par Jean-Baptiste Thoret, Paris, Ellipses, 2007.
[13] C’est-à-dire l’accidentel et le réel mis en scène par Gimme Shelter comme bascule symbolique des espoirs d’une génération (à la fois surgissement de la mort et du cadavre dans et par l’image) et la construction avec Romero d’une figure inédite prenante acte de l’extrême monstruosité par la mise en scène du corps-cadavre dévorant de l’effondrement de toute espérance.
[14] Fragment du 31 juillet 1978, Rolland Barthes, Journal de deuil, Op. Cit, p. 185 et 186.
